Bulletin n°21, juin 2007
L’Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, un jalon important dans la constitution de l’état des personnes (naissance, mariage, décès) et …ancêtre de la Loi 101!
L’Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539,
un jalon important dans la constitution
de l’état des personnes (naissance, mariage, décès) et
…ancêtre de la Loi 101!
Comme l’a fait, en 1977, la Loi 101 ou la Charte de la langue française, l’Ordonnance de 1539 impose une seule langue comme langue officielle de l’État. La langue maternelle choisie, c’est la langue française, mais en même temps celle du bassin parisien et des bords de la Loire. Désormais, les actes de l’administration royale centrale, la législation, les décisions de la justice et les contrats des notaires établissant le droit des personnes ne pourront plus faire appel aux langues « vulgaires » locales, ni au latin. Il devront être rédigés en français. S’il faut reconnaître le fait que des actes notariés sont encore rédigés en langue d’oc à la fin du 16e, il n’en reste pas moins que le coup d’envoi est donné pour doter les Français d’un des éléments de leur identité commune et, ainsi, unifier davantage un royaume encore trop éclaté.
L’Ordonnance de Villers-Cotterêts, préparée par le chancelier de François 1er, Guillaume Poyet, et signée par le souverain en août 1539, ne constitue pas une coupure radicale avec la situation antérieure. L’Ordonnance doit plutôt être vue comme une décision du pouvoir politique central, porteuse d’unité, étendant à tout le royaume des pratiques et des usages locaux qui remontaient sous certains aspects aux 14e et 15e siècle. C’est la volonté du roi de légiférer pour tous ses sujets et d’éliminer les disparités d’une province à l’autre.
En ce qui concerne l’état des personnes, déjà en 1539, des registres paroissiaux existent dans 41 départements français. Par contre, leur tenue ne découle que de décisions locales des autorités ecclésiastiques, c’est-à-dire de curé ou d’évêques qui rendent obligatoire leur préparation pour leurs propres diocèses. Il n’existe alors aucune règle applicable à l’ensemble des provinces de France.
Relativement à la langue d’usage, le français du bassin parisien et des bords de la Loire, qui est aussi celui de l’administration royale, devient de plus en plus utilisé. Les langues « vulgaires » locales ont encore cours. Toutefois, des influences nouvelles se font sentir : l’arrivée de l’imprimerie, la circulation du livre de même que les guerres européennes, qui mettent en contact les populations étrangères, facilitent la diffusion d’idées n’ayant pas cours jusqu’alors. En même temps, le goût de la lecture se répand. Les pronostics d’Érasme quant à l’usage universel du latin se révèlent de plus en plus irréalistes, la langue latine devenant davantage confinée au monde des érudits et des scientistes.
L’ordonnance de 1539 vient donc sanctionner une évolution en cours. La tenue de registres paroissiaux dans lesquels doivent être enregistrées les dates et heures des naissances de même que les décès des personnes, est étendue à toute la France. Désormais, elle ne repose plus sur l’initiative individuelle d’évêques diocésains, mais elle découle d’une décision unique du pouvoir royal central. Le roi manifeste clairement sa volonté d’étendre les bienfaits d’une justice plus équitable à tous les habitants de son royaume, clarifiant les droits successoraux et leur transmission; il désire mettre fin à des abus, telles la perception de bénéfices au nom de personnes décédées ou la transmission de successions à des enfants encore au berceau.
Les lecteurs sont invités à consulter le site Web de la ville de Villers-Cotterêts.
Gilles Durand
Rouen, une capitale au carrefour de la mémoire franco-québécoise
Rouen, une capitale au carrefour de la mémoire franco-québécoise
Rouen, capitale de la Normandie, est une ville bien incrustée dans la mémoire collective des Québécois.
Une même croyance religieuse
La ville occupe une place bien à part dans nos croyances religieuses. C’est là, sous l’occupation anglaise, que Jeanne d’Arc est jugée et condamnée à être brûlée vive sur la place du Vieux-Marché le 30 mai 1431. Les Français reprennent la ville en 1449 et le roi de France Charles VII fait réhabiliter Jeanne d’Arc en 1456. Pour perpétuer la mémoire de la sainte, une église moderne est construite sur la place du Vieux-Marché et inaugurée en 1979. Érigée sur plusieurs centaines d’années, la cathédrale témoigne également de cette ferveur religieuse.
Une histoire partagée
Rouen occupe une position particulière, étant située sur un méandre de la Seine à 120 kilomètres de la mer. Grâce à la marée qui se fait sentir jusque là, les grands navires peuvent parcourir la distance qui sépare la ville de la mer. Le port de Rouen, c’est un point de déchargement et de chargement, à la limite de la navigation maritime et fluviale. Profitant de leur position privilégiée, les Rouennais ont sillonné les mers du monde : ils vont pêcher la morue à Terre-Neuve; ils vont s’approvisionner au loin en matières premières comme les colorants pour le textile; ils exportent les produits manufacturés tels les draps. Les Rouennais explorent aussi les vastes espaces aux horizons infinis. Le découvreur du Mississippi, Robert Cavelier de La Salle, c’est un Rouennais. Après avoir atteint l’embouchure du Mississippi par ses sources en 1682, il réalise une autre expédition, cette fois par la mer, en 1684-1686, dans le but d’implanter une colonie française à l’embouchure du Mississippi. Malheureusement, l’explorateur dévie de sa route en s’engageant trop à l’ouest de l’embouchure du fleuve. Sa barque, La Belle, s’échoue près des côtes du Texas à 500 kilomètres de ce qui deviendra la Nouvelle-Orléans. En 1995, l’épave est retrouvée et elle est en cours de restauration au musée d’Austin au Texas. Une réplique de cette barque est en montre à l’heure actuelle au Musée national de la Marine à Paris.
La culture matérielle
Les Rouennais excellent aussi dans le commerce et dans l’industrie manufacturière. Ils se démarquent dans la fabrication des draps en particulier et, à compter du milieu du 18e siècle, dans la production d’« indiennes », un terme que nos grands-parents employaient souvent et qui correspondait à des tissus de coton imprimé bon marché. Les Rouennais se rendent jusqu’en Inde pour y vendre leur production.
Faire en sorte que le patrimoine trouve preneur auprès des générations futures
Rouen est beaucoup affectée par les bombardements de la seconde guerre mondiale dont le visiteur peut voir très clairement les traces encore aujourd’hui. Aux lendemains de la grande guerre, c’est le début de la reconstruction. Dans les années 1970 s’ajoutent d’importantes opérations de sauvegarde, comme la restauration des façades de bâtiments, la création de rues piétonnières, etc. Les Rouennais sont bien conscients de la valeur de leur patrimoine et y sont très attachés.
Des remerciements sincères de la part de Madeleine Côté et de Gilles Durand à Mme Bernadette Foisset de la Régionale Grand Quevilly-Québec de l’Association France-Québec pour avoir fait apprécier la vieille ville de Rouen – en particulier la paroisse où est baptisé René-Robert Cavelier de La Salle le 21 novembre 1643 – de même que pour avoir fait partager l’attachement de ses compatriotes à leur héritage ancestral.
Pour en savoir plus: http://www.rouentourisme.com/
Gilles Durand
Le Musée des arts et métiers de Paris, le « Louvre des techniques ». Concilier la préservation et la transmission d’un héritage religieux et technique
Le Musée des arts et métiers de Paris,
le « Louvre des techniques ».
Concilier la préservation et la transmission d’un héritage
religieux et technique
Le Musée des arts et métiers prend appui sur un double héritage. Des édifices conventuels construits par les moines bénédictins, à compter du 11e siècle. À partir de la Révolution, le prieuré et l’église Saint-Martin-des-Champs sont supprimés comme lieu de culte. En 1794, l’abbé Grégoire, un prêtre jureur, intervient auprès de la Convention nationale pour la transformation du lieu en conservatoire des arts et métiers. Le coup d’envoi est alors donné pour le musée.
Au fil des années, le Musée des arts et métiers progresse et enrichit ses collections au point qu’il renferme aujourd’hui quelque 80 000 objets et 15 000 dessins. Les objets sont constitués de machines, instruments et appareils, soit en grand, soit en modèle, témoignant de la marche et du progrès des inventions. À compter de 1990, l’église et le musée subissent des rénovations majeures sous l’impulsion de Dominique Ferriot. À l’heure actuelle, « à travers sept grands domaines [instruments scientifiques, matériaux, construction, communication, énergie, mécanique, transports] et quatre périodes-clefs [avant 1750, 1750-1850, 1850-1950, après 1950], l’exposition permanente offre à voir quelque six mille objets reflétant les facettes les plus variées de l’histoire des techniques ». En plus de pouvoir se familiariser avec une collection d’objets scientifiques touchant plusieurs domaines, le visiteur peut aussi prendre contact avec une tradition religieuse millénaire.
Une visite des plus enrichissantes autant pour les Français que les Québécois, qui peuvent par là se familiariser avec l’histoire des techniques, dont certaines n’ont pu manquer de passer en Amérique dans les bagages de nos ancêtres. Le Musée des arts et métiers, c’est une institution qui témoigne d’efforts pour concilier la transmission à la fois du patrimoine religieux et du patrimoine scientifique. Le lecteur aura avantage à ajouter, à la consultation du site Internet du Musé, celui du patrimoine religieux pour suivre les nouveautés qui y sont déposées . Est attendue la publication prochaine des actes du colloque organisé à Montréal en novembre 2006 et intitulé « Le patrimoine religieux du Québec – Éducation et transmission du sens » – voir aussi l’article de Robert Garon paru sous ce titre dans le dernier bulletin Mémoires vives, no 20, mars 2007, de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs.
Merci à Mme Dominique Ferriot, présidente du comité national français du Conseil international des musées (IcomFrance@wanadoo.fr ) d’avoir proposé et démontré tout l’intérêt de visiter une institution dont peut s’enorgueillir le centre de la ville de Paris.
Gilles Durand
Le château de Vincennes
Le château de Vincennes.
Le château de Vincennes, le plus important château royal subsistant par la hauteur de son donjon (50 mètres), est l’un des sites où les souverains français ont habité dans le passé.
Ce monument d’exception est au centre de l’histoire de France. Il tombe dans la catégorie des résidences principales des souverains. De telles résidences se retrouvent au centre de Paris, comme le palais du Louvre, mais aussi plus en périphérie, à l’abri des soulèvements populaires comme Vincennes ou le palais de Versailles. Au début de son règne, Louis XIV habite Vincennes, mais à compter de 1682, il déménage à Versailles. Le château de Vincennes a survécu aux vicissitudes du temps et, grâce aux travaux de restauration en cours, son donjon est réouvert au public en cette année 2007, qui peut être qualifiée de l’« année du château ».
Les souverains français ont aussi leur résidence « de campagne », comme le château de Villers-Cotterêts ou celui de Fontainebleau. Ces résidences secondaires ne sont pas uniquement des lieux pour s’adonner à la détente et à la chasse. Des décisions très importantes pour l’avenir du royaume sont aussi entérinées à l’occasion, par exemple la signature, en 1539, de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts par François 1er au château de Villers-Cotterêts – instituant l’état civil et faisant du français la langue administrative – ou bien encore la signature, en 1685, de l’édit de Fontainebleau par Louis XIV au château de Fontainebleau – révoquant l’Édit de Nantes et interdisant l’exercice de la religion protestante –.
Le château de Vincennes abrite le Service historique de la Défense, service à compétence nationale rattaché à la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) du ministère de la Défense. Ce service est de création récente, ayant été mis sur pied le 1er janvier 2005. Il est unique, résultant de la fusion des quatre services historiques de l’armée de Terre et de l’Air, de la Marine et de la Gendarmerie nationale. En principe, le SHD rassemble les archives postérieures à 1789 – celles antérieures à cette date étant conservées au Centre historique des Archives nationales situé au Centre de Paris –, mais en pratique la séparation n’est pas aussi tranchée. C’est ainsi que les manuscrits que le maître des fortifications a rédigés et expédiés au roi, aux princes et aux ministres, la correspondance qu’il a reçue et échangée avec les secrétaires d’État à la Guerre, tel Louvois, se retrouvent à Vincennes. Le SHD souligne le 300e anniversaire de la mort de Vauban en supportant la publication de l’ouvrage Vauban, l’intelligence du territoire, que Nicole Salat, chef de la section des archives techniques, a réalisé en collaboration avec Martin Barros et Thierry Sarmant.
Gilles Durand
Musée national de la Marine
Musée national de la Marine
Le musée national de la Marine est présent à Paris et dans quatre villes de province, sur le littoral atlantique, Brest, Port-Louis (citadelle de Port-Louis) et Rochefort, de même que sur le littoral méditerranéen, Toulon.
Le site de Paris est abrité par le Palais de Chaillot, construit pour l’exposition internationale de 1937 et situé face à la Tour Eiffel et au Champs de Mars. Le musée expose en permanence quelques-uns des trésors qu’il possède : modèles de navires (galère, trois-mâts, navire à vapeur, etc.), instruments de navigation, sculptures. Il présente aussi au visiteur une série de tableaux de l’artiste français Joseph Vernet; réalisés entre 1753 et 1765, à la suite d’une commande royale de 1750, les tableaux constituent des vues des ports de France de l’époque sur le littoral méditerranéen et atlantique.
Pour en savoir davantage, consulter le site Internet du Musée.
Gilles Durand
De Québec à l’Amérique française. Des lieux d’accomplissement de l’héritage de Champlain; les Actes du colloque de la Commission de septembre 2003
De Québec à l’Amérique française.
Des lieux d’accomplissement de l’héritage de Champlain;
les Actes du colloque de la Commission de septembre 2003
 Depuis sa création en décembre 1996, la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC) organise des colloques pour analyser l’état d’avancement des connaissances sur les lieux de mémoire franco-québécois et pour donner des orientations qui méritent d’être explorées. Les communications présentées lors de ces rencontres sont publiées pour en assurer la diffusion la plus large possible.
Depuis sa création en décembre 1996, la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC) organise des colloques pour analyser l’état d’avancement des connaissances sur les lieux de mémoire franco-québécois et pour donner des orientations qui méritent d’être explorées. Les communications présentées lors de ces rencontres sont publiées pour en assurer la diffusion la plus large possible.
La publication, De Québec à l’Amérique française. Histoire et mémoire1, fait suite au colloque tenu en septembre 2003, à Québec, au Musée de la civilisation. En 2001, une première rencontre avait été organisée à Poitiers – La Rochelle; elle portait sur le fait français envisagé sous l’angle du point de départ, la France. Lors du deuxième colloque, les participants ont plutôt examiné la question sous l’angle de son accomplissement, de Terre-Neuve à la chaîne des Rocheuses, de la Baie d’Hudson à la Louisiane. Thomas Wien, Cécile Vidal et Yves Frenette ont eu à colliger les textes de 23 des communications qui y avaient été présentées. Thomas Wien est responsable de l’introduction synthèse, dans laquelle il fait ressortir certaines interrogations auxquelles le lecteur pourra trouver réponse en parcourant l’ouvrage.
La présente publication analyse l’Amérique française sous différents angles : les ressources pour l’étudier et la connaître, les images que des hommes de terrain en ont laissé, les recherches et les activités de mise en valeur en cours. Elle constitue à la fois un bilan et une introduction aux grands chantiers en marche.
Des ressources abondantes à exploiter
À compter du deuxième quart du 18e siècle, les sources de première main deviennent mieux organisées et plus accessibles. Les historiens ont ainsi accès à un bassin d’information plus vaste, qui leur permet de délaisser plus facilement les conflits opposant Français, Anglais et Amérindiens et d’étudier le « paisible quotidien des colons français » (Thomas Wien, p. 65 et suivantes). Les sources se diversifient. Par exemple, les recensements nominatifs s’ajoutent aux grandes enquêtes sur l’émigration des Canadiens français – dont les rapports sont publiés par le gouvernement canadien en 1849 et en 1857 – pour permettre de quantifier et de suivre leurs déplacements en territoire américain (Bruno Ramirez, p. 267 et suivantes; Jean Lamarre, p. 283 et suivantes). Couplés à d’autres sources – registres de mariage et bottins téléphoniques –, les recensements permettent encore, par le biais des noms de famille qu’ils renferment, de constituer des balises patronymiques pour suivre le déplacement des familles dans l’espace (Kevin Henry et Sherry Olson, p. 251 et suivantes).
La cartographie contribue à faire avancer les connaissances sur le territoire. Devant les difficultés que présentent les voyages outre-mer, les pionniers, tels Claude Delisle et son fils Guillaume, doivent se contenter du titre de cartographes de cabinet et mettre en forme des données rassemblées à distance par des hommes de terrain non spécialisés dans le domaine, tels les administrateurs, militaires et voyageurs. Ils n’en contribuent pas moins à ébaucher et à rendre plus nets les contours de l’Amérique française (Christian Morissonneau, p. 195 et suivantes; Pierre Ickowicz, p. 317 et suivantes.) Ils pavent la voie à leurs successeurs immédiats et futurs, les géographes culturels du dernier quart du 20e siècle qui pourront se déplacer plus facilement sur le terrain et réaliser des enquêtes avec leurs étudiants (Eric Waddell, p. 227 et suivantes.). De façon à préserver et à assurer une meilleure diffusion de toute cette production, des mécènes s’impliquent : à compter du début des années 1970, David Macdonald Stuart rassemble, au musée qui porte son nom, l’une des plus importantes collections cartographiques, plus de 600 titres (Guy Vadeboncoeur, p. 349 et suivantes).
Les imprimés, enfin, constituent une source d’information irremplaçable pour la connaissance de l’Amérique française et des traces qui en témoignent. Conservateurs d’objets dont ils doivent connaître la nature et la provenance et la communiquer au public, les musées s’engagent dans l’acquisition et la conservation d’ouvrages publiés. Le Musée Stewart rassemble une collection importante de livres rares (Guy Vadeboncoeur, p. 349 et suivantes). Le Château-Musée de Dieppe fait de même en réunissant des publications sur les relations entre la Normandie et la Nouvelle-France. Préparés « sous l’œil normand », ces travaux traitent de sujets aussi divers que « la pêche normande à Terre-Neuve », « les représentations du nouveau monde dans la cartographie dieppoise », « les huguenots cauchois à Québec », etc. (Pierre Ickowicz, p. 317 et suivantes). Prenant conscience des responsabilités à l’égard de la collectivité de langue française en Amérique du Nord que lui avait dictées le 1er Congrès de la langue française tenu en 1912 sur son site, le Séminaire de Québec intègre la bibliothèque ancienne au projet de musée et archives : une collection de « plus de 180 000 livres rares » (Yves Bergeron, p. 357 et suivantes ).
Les points de vue se multiplient. La mémoire collective est étoffée
Au fur et à mesure que la Nouvelle-France s’éloigne, les frontières de l’Amérique française varient, mais les points de vue se multiplient de la part des locuteurs et des scripteurs.Dès le début de l’ouvrage, le lecteur est mis en garde contre les orientations de ceux qui écrivent. Déçu d’un pouvoir politique qui ne lui accorde pas l’avancement militaire désiré, le baron Louis Armand Lahontan prend la plume au début du 18e siècle en ironisant sur tout. Il parsème son récit de détails incongrus, écrivant par exemple à propos de l’attaque de Phips contre Québec : « cette Flote, laquelle par bonheur pour nous, s’amusoit à gober des mouches à deux lieuës de Québec ». Il ne faut pas en conclure pour autant à l’inutilité de l’écrit (Réal Ouellet, p. 29 et suivantes ). Plus près de nous, en 1924, le choix de l’année 1624 – plutôt que 1626 –, pour marquer le tricentenaire de la fondation de New York, s’explique par le prosélytisme de deux auteurs, Louis Effingham de Forest, l’un des descendants de Jesse de Forest, et Charles-N. Peltrisot, ancien maire du chef-lieu d’Avesnes-sur-Helpe; le premier veut perpétuer le souvenir de son héroïque ancêtre et des Huguenots-Wallons, le deuxième tente d’attirer les touristes new-yorkais – le fondateur de la ville de New-York serait né à Avesnes-sur-Helpe – (Caroline-Isabelle Caron, p. 175 et suivantes). Dans ce cas-ci, il faut tenir compte des objectifs poursuivis par les deux auteurs.
Sans aller aussi loin que les exemples ci-dessus, d’autres images de l’Amérique française, comportant des variantes, circulent au 19e et au 20e siècle. À Montréal, dans les années 1850, l’évêque du diocèse, Mgr Ignace Bourget, fait de la Nouvelle-France catholique et française le fondement de cette Amérique qui doit préserver l’héritage reçu et le transmettre intact aux générations futures : « il ne s’agit plus seulement d’un âge d’or remarquable et révolu… mais aussi, et surtout, de la source fondatrice d’une collectivité dotée de caractéristiques culturelles particulières et qui survit depuis lors » (Ollivier Hubert, p. 49 et suivantes). De l’autre côté de la frontière, en Nouvelle-Angleterre, au tournant des années 1920, certains penseurs ne peuvent rester indifférents à l’assimilation progressive de leurs compatriotes et à la nécessité pour eux de s’intégrer à la société américaine. Plutôt que rester fidèles à la devise « la langue gardienne de la foi », ils proposent l’introduction de l’anglais à l’église paroissiale et un meilleur apprentissage de cette langue à l’école – certains suggérant même l’enseignement du français comme langue seconde –, en somme « un archipel » de race française – distinguer de la langue – et de religion catholique (Yves Roby, p. 157 et suivantes ).
Au Québec, à compter des années 1830, sans abandonner les frontières traditionnelles de l’Amérique française, d’autres penseurs et homme d’action proposent plutôt leur extension vers le Nord. Alexis de Tocqueville, Edme Rameau de Saint-Père, Étienne Parent et le curé Antoine Labelle entrevoient les dangers que fait courir l’émigration massive aux États-Unis. Pour préserver leurs traits distinctifs, les Canadiens français doivent investir des territoires vierges, non encore occupés par les Anglais (Christian Morissonneau, p. 195 et suivantes). De son côté, l’historien et prêtre engagé, Lionel Groulx, se démarque de ses prédécesseurs, non pas tant par sa conception continentale de l’Amérique française, une Amérique de langue française et de religion catholique, que par l’accent mis sur certaines valeurs : la mission confiée à ses compatriotes par la Providence et leurs responsabilités à l’égard des minorités; l’importance de celles-ci comme points d’ancrage du fait catholique et français à l’extérieur du Québec (Michel Bock, p. 209 et suivantes).
Comme toutes les autres sciences, l’histoire s’est beaucoup développée. L’approche a changé depuis les « pages blanches » de la période de paix 1713-1744, pour laquelle les historiens trouvaient peu à dire (Thomas Wien, p. 66). L’étude des côtés économique et social de l’Amérique française s’accentue. À compter du milieu des années 1990, le Québec est abandonné comme seul point principal d’observation de l’Amérique française. Face à la vallée du Saint-Laurent et à la Louisiane, le Pays-d’en-Haut et la Haute-Louisiane ne sont plus considérés seulement comme des territoires de passage. Les historiens scrutent d’une façon plus pénétrante leur économie et leur société en faisant appel aux archives notariales et judiciaires locales. Ils étudient les liens commerciaux entre ces collectivités, remettant même en cause le rôle prétendument effacé de l’État français – par exemple « la mise en place par la Compagnie des Indes, puis l’État, d’un système régulier de convois entre Kaskaskia et La Nouvelle-Orléans » (Cécile Vidal, p. 130). Ils effectuent des comparaisons entre les comportements des sociétés cosmopolites – de souches française, autochtone, allochtone – dont se compose l’Amérique française dans sa dimension continentale (Amérique du Nord) et insulaire (Antilles) (Gilles Havard, p. 95 et suivantes; Cécile Vidal, p. 125 et suivantes; Paul Lachance, p. 139 et suivantes ).
Les musées prennent la place qui leur revient
L’ouvrage mentionne l’apport indispensable des musées québécois et français à la mémoire commune. Pour le côté français, Pierre Ickowicz, conservateur en chef du Château-Musée de Dieppe, nous entretient de la qualité du témoignage des découvertes archéologiques, prenant comme exemple le cas de gourdes sphériques identiques à celles trouvées dans l’habitation de Champlain et produites dans l’arrière-pays dieppois (p. 319 et suivantes). Dans une liste placée en annexe de son texte, Pascal Mongne ne dénombre pas moins de 40 musées français qui conservent des objets à caractère archéologique et ethnographique provenant de la Nouvelle-France (Pascal Mongne, p. 331 et suivantes). De ce côté-ci de l’Atlantique, les conservateurs réservent pour leur musée, dans le contenu de cette publication, une place qui se démarque; c’est le cas de Pointe-à-Callière, musée d’histoire et d’archéologie de Montréal (Francine Lelièvre, p. 301 et suivantes), le Musée canadien des civilisations (Jean-Pierre Hardy, p. 307 et suivantes ), le Musée Stewart (Guy Vadeboncoeur, p. 349 et suivantes ), le Musée de l’Amérique française – celui-ci est créé dans les années 1990, mais il prend naissance en 1806 dans les murs du Séminaire de Québec – (Yves Bergeron, p. 357 et suivantes ).
Les musées québécois se signalent tant par la quantité et la qualité des objets conservés que par leur programme de diffusion. Le Musée Stewart assure, entre autres, la mise en valeur d’une collection de plus de 2 500 ustensiles d’âtre, de cuisine et d’éclairage et de plus de 3 000 armes à feu et armes blanches (Guy Vadeboncoeur, p. 349 et suivantes ). Yves Bergeron souligne, à propos de la publication en 1996 de l’inventaire des 120 000 objets du musée sous le titre Trésors d’Amérique française, que l’ouvrage ne met plus en doute l’intérêt des collections (Yves Bergeron, p. 357 et suivantes ). Côté diffusion, les musées font rayonner le fait français dans toutes ses dimensions, autant économique et sociale que politique, en travaillant en collaboration, soit pour le prêt d’objets, soit pour le montage et la circulation des expositions (Francine Lelièvre, p. 301 et suivantes ; Jean-Pierre Hardy, p. 307 et suivantes ; Guy Vadeboncoeur, p. 349 et suivantes ).
Des projets à signaler, l’un en chantier, l’autre dont les bases sont jetées
Historiens, archivistes et muséologues ont beaucoup contribué à diffuser des connaissances et à entretenir le souvenir de la France et de l’Amérique française. Le travail n’est pas terminé pour autant, il se poursuit toujours.
À l’initiative de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, deux groupes de travail ont été à l’œuvre depuis 2001, l’un en France, l’autre de ce côté-ci de l’Atlantique, pour inventorier et mettre en contexte les bâtiments, monuments, plaques, etc., qui relient le Québec et plus largement l’Amérique à la France (Samantha Rompillon et Alain Roy, p. 371 et suivantes ; Aline Carpentier et Elsa Guerry, p. 375 et suivantes ; Samantha Rompillon, Dominique Malack, Peter Gagné et Laurent Richard, p. 387 et suivantes ). Le projet est soutenu par les gouvernements français et québécois de même que par les universités Laval, de La Rochelle et de Poitiers. Du côté français, il est terminé pour la Région Poitou-Charentes, mais des extensions sont prévues pour d’autres régions rattachées à la côte atlantique française. Du côté Amérique, il se poursuit actuellement au Québec de même qu’en Acadie, en Ontario, et dans les provinces des Prairies. Éventuellement, le territoire des États-Unis sera au programme. Les renseignements recueillis sont versés dans une base de données commune au Québec et à la France. Des sous-produits du travail réalisé sont prévus, par exemple la production et la publication d’un atlas historique. Déjà, l’inventaire promet beaucoup pour enrichir et stimuler la mémoire franco-québécoise : en faisant revivre des lieux oubliés, en permettant « de suivre l’itinéraire d’un migrant, de retracer des circuits commerciaux ou tout simplement de constater l’existence d’un ensemble historique lié par bien des événements » (Samantha Rompillon et Alain Roy, p. 374).
Les musées français qui conservent des artefacts ou des objets muséologiques touchant la Nouvelle-France envisagent d’adopter une démarche semblable. Déjà, la première étape est franchie; les musées détenteurs d’objets relatifs à la Nouvelle-France sont identifiés (Pascal Mongne, p. 331 et suivantes). Reste maintenant à étudier chaque objet, à déterminer sa nature et le matériau dont il est construit de même qu’à établir sa provenance, notamment les circonstances qui ont provoqué sa traversée de l’Atlantique. Par la suite, les données seront entrées dans une base informatique et mises en ligne aux fins de diffusion.
L’ « ultime maillon de la chaîne de découverte et d’étude : le public » ne doit jamais être oublié (Pascal Mongne, p. 340).
De Québec à l’Amérique française. Histoire et mémoire. Textes choisis du deuxième colloque de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, sous la direction de Thomas Wien, Cécile Vidal et Yves Frenette, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006, 403 p.
Gilles Durand
Premières nations, collections royales : Le catalogue de cette exposition présentée à Paris et à Montréal
Premières nations, collections royales : Le catalogue de cette exposition présentée à Paris et à Montréal
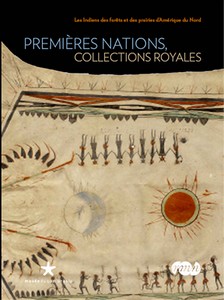
Crédit : Musée du quai Branly |
Premières nations, collections royales : Les Indiens des forêts et des prairies d’Amérique du Nord, sous la direction de Christian Feest, conservateur au museum für Völkerkunde de Vienne, coédition musée du quai Branly/Réunion des musées nationaux, 96 pages.
Le catalogue d’une exposition présentée à Paris, au musée du quai Branly, du 13 février au 13 mai 2007, et à Montréal, au musée de Pointe-à-Callière, du 5 juin au 14 octobre 2007.
Les auteurs sont :
- Gilles Havard, Centre de recherches sur l’histoire des États-Unis et du Canada, université de Paris VII
- Sylvia Kasprycki, Institut für Historische Ethnologie, Francfort
- Pascal Riviale, conservateur au musée d’Orsay
L’exposition présente, pour la première fois depuis des décennies, les plus importants objets du musée du quai Branly en rapport avec les premières nations du Canada et des États-Unis. En les replaçant dans le contexte de l’histoire des collections ethnographiques françaises, ce projet permet de prendre conscience de l’intérêt profond porté par l’Europe pour d’autres régions du monde et la manière dont elle a préservé l’héritage culturel de l’humanité. L’ouvrage publié à cette occasion est une étude exceptionnelle des liens qui ont uni la France et l’Amérique du Nord dès le XVIIe siècle. Il s’attache particulièrement au regard porté, en France, sur des objets qui, après avoir été considérés comme des curiosités “sauvages”, sont ensuite devenus de véritables objets d’ethnographie.
Recueillis par des explorateurs, des officiers, des commerçants ou des missionnaires, en poste dans les états de la Nouvelle-France ou de la Louisiane, ces objets ont fait partie des collections royales. Un ensemble important a été déposé à la Bibliothèque nationale de France au cours de la Révolution française, les armes ont été regroupées au Musée de l’Armée. Une autre collection a été transférée à la bibliothèque municipale de Versailles. Entre 1878 et 1934, ces pièces ont été réunies au sein du Musée d’Ethnographie du Trocadéro (futur musée de l’Homme). Aujourd’hui, dans le cadre du musée du quai Branly, le public international (re)découvre ces trésors, quasi inconnus.
Pour des informations additionnelles sur la publication, consulter le site Internet du musée du quai Branly.
Cette exposition est présenté au musée de Pointe-à-Callières : voir autre texte.
La culture québécoise est-elle en crise ?
La culture québécoise est-elle en crise ?
L’historien et sociologue Gérard Bouchard, en collaboration avec Alain Roy, vient de publier La Culture québécoise est-elle en crise? aux Éditions du Boréal. Les Éditions font, sur leur site Internet, une présentation sommaire de l’ouvrage que le lecteur trouvera ci-dessous. En même temps, elles renvoient à une interview qu’Élias Levy a réalisé un entretien avec l’auteur. : Selon ce dernier, l’indépendance nationale est la solution à la crise actuelle de la culture, car elle créerait un mythe, une force susceptible de mobiliser les Québécois et de les amener à passer à l’offensive pour réaliser de nouveaux projets plutôt que de rester sur la défensive comme ils le sont à l’heure actuelle.
Le lecteur pourra également consulter avec profit un article de Stéphane Baillargeon paru dans Le Devoir du 30 avril 2007 et accessible sur le site. Dans cet article, le journaliste fait sur le point sur les grandes idées qui se sont dégagées d’une rencontre organisée par l’Institut du Nouveau Monde les 27 et 28 avril dernier, et de la conférence de clôture prononcée par Gérard Bouchard. Rapportant ses propos, Stéphane Baillargeon écrit :
Bref, pour l’historien et le sociologue, il faudrait que la société québécoise redevienne un mythe. Il a cité l’exemple tout proche offert par la société américaine. « Il n’y a pas de société plus diverse, plus divisée, plus en contradiction, a-t-il dit. Mais pourquoi marche-t-elle? À cause de la puissance de ses mythes nationaux, l’idée du bonheur, de la liberté, d’une foi en l’avenir. Malgré les échecs, ceux de l’égalité par exemple, l’American dream, demeure, et le meilleur semble toujours à venir aux États-Unis. »
Pour en savoir plus visitez le site des Éditions du Boréal.
Gilles Durand
Le français, troisième langue principale en Amérique du Nord au 21e siècle
Le français, troisième langue principale en
Amérique du Nord au 21e siècle
Dans un article intitulé Franco America et signé par Philip Marchand, l’édition électronique du Toronto Star du 29 avril 2007 présente les principales conclusions d’un symposium tenu à l’University of Southern Maine en mars dernier, qui réunissait une vingtaine de géographes et d’historiens des États-Unis et du Canada. Selon ces derniers, il est à prévoir que le français en viendra à occuper la troisième position en Amérique du Nord après l’anglais et l’espagnol. Le quotidien d’Ottawa, Le Droit, dans son édition du 1er mai dernier, reprend également les mêmes conclusions dans un article signé par Adrien Cantin et intitulé La grande francophonie d’Amérique, projet du XXI siècle?. L’idée est parrainée, entre autres, par les géographes Dean Louder et Eric Waddell de l’Université Laval, par l’historien J. Yvon Thériault de l’Université d’Ottawa de même que par le géographe Barry Rodrigue de l’University of Southern Maine. Un ouvrage collectif est en préparation sur le sujet et devrait paraître en 2008.
Comment cette assertion se justifie-t-elle?
Même si le français n’est plus parlé que par deux pour cent des francophones en Amérique du Nord, on reconnaît qu’il a plus de force et de visibilité qu’auparavant, par exemple en matière de l’étiquetage souvent trilingue des produits manufacturés et des manuels d’instruction préparés pour les accompagner.
Face à la mondialisation, on prévoit d’ici 50 ans que les États d’Amérique du Nord s’uniront, le Canada, les États-Unis, le Mexique et les Caraïbes formeraient ainsi une grande fédération. En même temps, ce mouvement pourrait s’accompagner d’une décentralisation du système politique des États-Unis, les 50 États actuels seraient organisés en régions et formeraient une douzaine de républiques. Dans ces espaces plus autonomes et restreints comme la Nouvelle-Angleterre ou comme la Louisiane, les francophones pourront acquérir plus facilement de l’importance et de la reconnaissance. Ils donneront le ton et inspireront les francophones d’ailleurs à revendiquer eux aussi une place plus grande. Il faut éviter l’amnésie chez les francophones et entretenir le feu sacré quand ce n’est pas tout simplement le communiquer, si on veut permettre de surmonter les obstacles. En effet, l’affirmation et la mise en valeur du fait français en Amérique du Nord constituent pour plusieurs une violation : pour des Québécois, c’est une violation des frontières d’un Québec souverain; pour d’autres, des Canadiens, c’est une violation des frontières du Canada; enfin pour des Américains, c’est une violation du mythe du « melting pot ».
Quels sont les atouts du français pour devenir la troisième langue principale?
Tout d’abord le support d’un gouvernement en Amérique du Nord, celui du Québec, entité politique à laquelle les francophones peuvent toujours se référer – tout en reconnaissant que le Québec est la seule entité politique en Amérique du Nord –.
Les francophones n’ont pas seulement une langue définissant leur identité, mais ils ont aussi un héritage culturel plus large, des coutumes et des traditions auxquels ils restent attachés. Un tel attachement à leur identité ne peut se retrouver dans les autres communautés d’immigrants, car seuls les francophones ont participé à l’exploration et à la mise en valeur de l’ensemble du continent et ce, depuis les tout premiers débuts, de même qu’ils ont entretenu des relations intimes avec les Premières nations.
Le Droit ajoute en citant J. Yvon Thériault : « Mais il ne faut pas chercher, comme au Québec, à créer un projet de société autour de la langue française. Ce ne serait pas possible. Non, ce ne serait pas une société comme telle, mais davantage un réseau de sensibilités qui permettrait de reconstruire une certaine solidarité (francophone) nord-américaine qui n’est pas insignifiante ».
Gilles Durand
Pour revivre l’aventure des Sulpiciens durant trois siècles et demi
Pour revivre l’aventure des Sulpiciens
durant trois siècles et demi
Les Sulpiciens de Montréal, une des trois provinces de la Compagnie de Saint-Sulpice dont la maison mère est en France, fêtent, en 2007, leur 350e anniversaire d’arrivée. Conscients de l’importance de leur contribution au développement de Montréal et de la richesse du patrimoine qu’ils ont accumulé et préservé, ils ont voulu célébrer leur arrivée en 1657 de deux manières : par des activités spéciales qui se dérouleront tout au long de l’année de même que par une publication de prestige commandée à trois historiens.
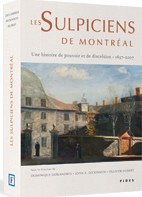
Crédit photo :Les Éditions Fides |
L’ouvrage, intitulé Les Sulpiciens de Montréal. Une histoire de pouvoir et de discrétion 1657-2007, est paru aux Éditions Fides en février 2007. Elle comprend 670 pages réparties en vingt-et-un chapitres, préparés sous la direction de Dominique Deslandres, John A. Dickinson et Ollivier Hubert avec la collaboration d’historiens bien au fait de l’histoire de la communauté et de la société montréalaise au sein de laquelle elle a œuvré. Une iconographie abondante, choisie judicieusement sous les soins de Jacques Des Rochers, accompagne le récit dont plus de la moitié des chapitres (11) apparaissent sous la plume des trois directeurs.
L’ouvrage fait revivre l’aventure en sol québécois des membres de la Province canadienne de la Compagnie de Saint-Sulpice. Tous les aspects de l’histoire de la Compagnie sont abordés, des volets plus spécifiques de ses activités faisant suite à la présentation de vues d’ensemble.
La communauté, ses membres, les grands moments de son aventure
L’ouvrage fait d’abord revivre les grands moments qui ont marqué l’histoire de la Compagnie et qui, à l’occasion, ont constitué des tournants dans ses activités missionnaires, pastorales et éducatives. Il présente la communauté en regard de la mission tracée par son fondateur, Jean-Jacques Olier, de sa structure et de la nature du lien — associatif — qui soude les membres entre eux dans leur résidence plus que tricentenaire, le Séminaire de Saint-Sulpice du 116, rue Notre-Dame Ouest. La publication renferme aussi une biographie collective de la communauté permettant de valider les grandes conclusions — secteurs dans lesquels les Sulpiciens ont concentré leurs activités à travers le temps — qui se dégagent au terme des études réalisées par les auteurs. Cette biographie prend appui sur une base de données prosopographique rejoignant les 650 associés de la Province canadienne depuis 1657 jusqu’à aujourd’hui; en regard de chacun, la base donne le nom et le prénom, l’année et le diocèse de naissance, l’année d’ordination et de sortie de naissance. Par la suite, des chapitres prennent la relève pour présenter le résultat d’analyses plus en profondeur de certaines activités des Sulpiciens qui ont mobilisé leur énergie et qui ont constitué la raison d’être de leur présence en sol québécois.
Les Sulpiciens comme seigneurs et propriétaires
Comme c’est la coutume au 17e siècle de soulager le trésor royal des dépenses reliées au support des colonies, les principaux acteurs qui y oeuvrent sont dotés. De façon à ce qu’ils puissent subvenir à leur subsistance et fournir à la collectivité québécoise des services de base, tels des places fortifiées de refuge et de défense et des moulins pour moudre le grain, les Sulpiciens reçoivent, en 1663, les seigneuries de l’île de Montréal et de Saint-Sulpice — la Société de Notre-Dame se démet en leur faveur —, et, en 1717, celle du Lac des Deux-Montagnes, concession royale suivie d’une augmentation en 1733. Le Séminaire de Saint-Sulpice sert alors de résidence aux membres de la communauté et de manoir seigneurial, où sont acheminés les revenus provenant des droits payés par les censitaires et des domaines que le Séminaire possède pour son propre usage.
La vie suit ainsi son cours jusqu’en 1840. Une loi passée en cette année abolit le système de tenure auquel est assujettie la Compagnie de Saint-Sulpice — l’abolition générale du système seigneurial pour l’ensemble du Québec aura lieu 14 ans plus tard, en 1854 —. La maison de Montréal acquiert la personnalité juridique requise pour ne plus avoir à se référer à la maison mère française. Désormais, elle possède en toute propriété les biens qu’elle s’est réservés en propre pour se ravitailler, qu’elle a défrichés, aménagés et sur lesquels elle a construit, dans le Vieux-Montréal, au domaine de la Montagne et à celui du Sault-au-Récollet. Les biens immobiliers de la Compagnie s’avéreront, tout au long de ces trois siècles et demi, des sources de revenus indispensables pour supporter les nombreuses initiatives qu’elle prend, pour pallier des conjonctures adverses et, en définitive, pour échapper à la faillite en raison de placements à perte faits par un de ses employés au début du 20e siècle.
Les Sulpiciens comme missionnaires
L’évangélisation des autochtones fait partie de la mission confiée aux Sulpiciens par leur fondateur parisien, Jean-Jacques Olier. Pour la réaliser, ils adoptent l’approche de la francisation, la vie en réserve. L’énergie déployée par les Sulpiciens pour la relocaliser, du domaine de la Montagne au Sault-au-Récollet, puis, de nouveau en 1721, au Lac des Deux-Montagnes, ne suffit pas à leur assurer le succès. Au 19e siècle, les Iroquois de la mission d’Oka revendiquent un droit de coupe de bois — pour la vente et non pour leur seul usage personnel — sur le domaine de la communauté de même que la propriété de leurs terres. Les Sulpiciens tentent de multiplier au milieu d’eux les établissements français et canadiens. Les Trappistes répondent positivement en achetant, en 1881, 1000 acres de terre pour y établir un institut agricole et une ferme modèle dont la réputation du fromage n’est plus à faire. Par contre, ils ne peuvent régler définitivement la question des revendications des Iroquois, même en achetant un canton ontarien, Gibson, et en supportant le départ et l’établissement sur celui-ci des mécontents — plusieurs familles ont apostasié —. Dans les années 1930, voyant qu’ils n’ont plus leur raison d’être dans une mission qui a abandonné en grand nombre le catholicisme, les Sulpiciens accélèrent la vente des propriétés qu’ils possèdent, non sans laisser dans la paroisse un héritage d’inspiration française. Le presbytère d’Oka (Deux-Montagnes) du 181, rue des Anges, rebâti après l’incendie de 1923, est aujourd’hui déclaré site du patrimoine par la municipalité. Dorénavant, les Sulpiciens se tournent du côté du Japon et de l’Amérique latine pour exercer leur apostolat missionnaire; là, ils connaissent le succès.
Les Sulpiciens comme curés de paroisse
S’il est une fonction dans l’exercice de laquelle les Sulpiciens se démarquent, c’est celle de pasteurs de la grande paroisse de Notre-Dame, à l’image de la grande paroisse de Notre-Dame de Paris. Pour la desservir, ils procèdent à la construction de ce qui est aujourd’hui deux basiliques, empruntant toutes deux à l’architecture française. La première, l’église Notre-Dame, par sa localisation en plein centre-ville et par ses dimensions imposantes, marque avec force le fait catholique et français. Elle explique la localisation de la cathédrale, dénommée aujourd’hui basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-Jacques-le-Majeur, en périphérie de la vieille ville, d’abord à l’angle des rues Sainte-Catherine et Saint-Denis, par la suite à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la rue de la Cathédrale. La deuxième basilique, l’église Saint-Patrick, au service de la communauté irlandaise de langue anglaise, affirme haut la présence catholique dans cette partie de la ville occupée par les protestants. Les Sulpiciens laissent également en héritage des chapelles facilitant la desserte du grand territoire qui est le leur, la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours du 400, rue Saint-Paul Est, incendiée et relevée en 1771, de même que témoignant de l’importance accordée au culte à Marie, la Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, du 430, rue Sainte-Catherine Est, inaugurée en 1876, œuvre de grande qualité architecturale et artistique — la toponymie de Montréal porte abondamment la marque de la dévotion de la communauté à Marie —.
Tout à côté de l’église paroissiale, monumentale, le Séminaire de Saint-Sulpice — qu’il ne faut pas confondre avec le petit séminaire ou Collège de Montréal —, résidence plus que tricentenaire des Sulpiciens, domine la vieille ville. Il témoigne à la fois de leur mission de pasteur, de leur conformité à l’une de leur règle, la vie en communauté, et de leur fidélité au modèle français : la grande paroisse, desservie à partir d’un point unique n’obligeant pas les pasteurs à s’isoler des membres de la communauté pour accomplir leurs charges. Avec la croissance de la population, les Sulpiciens doivent se résigner à la subdivision de leur paroisse par l’évêque de Montréal. Désireux d’en arriver à des unités plus près d’une population qui s’étend continuellement dans l’espace, Mgr Ignace Bourget entreprend, à compter de 1865, la création de nouvelles paroisses à même le territoire de la paroisse initiale de Notre-Dame. Progressivement, compte tenu de leurs effectifs, les Sulpiciens doivent se retirer de certaines cures. Ils orientent alors leurs effectifs, affectés aux charges presbytérales, vers un meilleur encadrement des ouailles, par la prédication et par une présence soutenue dans les confréries de dévotion qui se multiplient, telles par exemple les confréries de la Sainte-Famille, du Scapulaire, du Rosaire.
Les Sulpiciens comme éducateurs et formateurs
Si les Sulpiciens sont des pasteurs et des missionnaires, ils sont d’abord et avant tout des éducateurs, des formateurs de la jeunesse et du clergé diocésain.
Une jeune colonie comme la Nouvelle-France ne nécessite pas à ses débuts des institutions d’enseignement poussé. Les Sulpiciens investissent d’abord le secteur de l’enseignement élémentaire. Ils financent et dirigent de petites écoles, mais ne s’impliquent pas dans la tâche d’enseignement proprement dite. Ils en confient la responsabilité de préférence aux membres de communautés religieuses ou, à défaut, à des étudiants en théologie ou à des instituteurs et des institutrices laïques. L’engagement des Sulpiciens dans la formation élémentaire va décroissant à la fin du 19e siècle. À compter de 1906, il n’y a plus de Sulpicien agissant comme commissaire d’école; les dernières écoles à être financées par la communauté sont l’école Saint-Jacques, jusqu’en 1920, et l’école Saint-Laurent, jusqu’en 1930. Le secteur public a bien en main la relève et il épaule le privé.
La fin du 18e siècle et le tournant du 19e siècle amènent le besoin d’une formation plus poussée. Les Sulpiciens reconnaissent le bien-fondé des disciplines profanes. Ils financent le Collège Saint-Raphaël (1774-1803), par la suite le petit séminaire du faubourg des Récollets (à compter de1806) qui emménage au domaine de la Montagne en 1862 — aux côtés du Grand Séminaire déjà présent depuis 1857 —, pour devenir le célèbre Collège de Montréal du 1931, rue Sherbrooke Ouest.
Déjà, en 1840, le contexte n’est plus le même. Mgr Bourget confie, cette année-là, la formation du clergé diocésain aux Sulpiciens. Ceux-ci aménagent d’abord le Grand Séminaire de Montréal dans des locaux du petit séminaire — qui devient le Collège de Montréal — et entreprennent la construction d’un bâtiment au domaine de la Montagne, au 2065, rue Sherbrooke Ouest, qui ouvre ses portes en 1857. Avec le temps, ils mettent davantage l’accent sur la formation sacerdotale. Le Collège de Montréal perd les deux dernières années du cours classique, les plus prestigieuses comme certains disent à l’époque, au profit du Séminaire de philosophie, une institution préparatoire au Grand Séminaire, qui ouvre ses portes en 1876, au domaine de la Montagne, plus précisément au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges. De 1911 à 1927, une école ayant comme principale mission de préparer au Séminaire de philosophie, est aussi en opération au domaine de la Montagne, l’École Saint-Jean-l’Évangéliste.
Le 20e siècle marque le retour du balancier. Les Sulpiciens se tournent davantage vers les étudiants qui se destinent à des professions autres que la carrière sacerdotale. En 1927, ils créent le premier externat classique, le Collège André-Grasset, dans la partie sud-est de leur domaine du Sault-au-Récollet, au 1001, boulevard Crémazie Est. En 1951, ils implantent un autre externat classique à Verdun, en milieu populaire, le Collège Jean-Jacques-Olier, institution constituant une sorte d’annexe du Collège de Montréal. Du côté de l’enseignement universitaire, les Sulpiciens ne sont pas en reste. Ils contribuent par leurs ressources financières et leurs membres au développement de l’Université de Montréal — Mgr Olivier Maurault sera recteur de l’Université de Montréal —.
La révolution tranquille et ses conséquences, la sécularisation de l’enseignement, l’intervention du secteur public et la désaffection des étudiants pour la carrière sacerdotale, amènent les Sulpiciens à réorienter leur action. Ils se retirent du Collège Jean-Jacques-Olier de Verdun en 1965. Dans les années 1990, ils confient les collèges de Montréal et André-Grasset à des corporations privées autonomes. Le Séminaire de philosophie est aujourd’hui rattaché au Collège Marianopolis. Par là, les Sulpiciens peuvent mieux recentrer leur action au Grand Séminaire, sur la mission première qui leur avait été confiée par leur fondateur, la formation du clergé — la communauté des Sulpiciens n’accepte que des prêtres déjà ordonnés qui doivent franchir l’étape de la « solitude » avant de devenir pleinement associés — dont une partie importante des aspirants provient de leur mission au Japon et en Amérique latine.
Les Sulpiciens sont-ils des « travailleurs sociaux »?
Les Sulpiciens ne sont pas une communauté ayant l’assistance sociale comme objectif prioritaire. Nulle surprise que le mémoire présenté à la Commission de la culture, en 2005, ne mentionne aucune propriété, affectée aux œuvres caritatives, comme ayant une très grande valeur en matière de patrimoine culturel.
Les Sulpiciens n’en jouent pas moins un rôle important à Montréal dans le secours aux plus démunis, en particulier dans la seconde moitié du 19e siècle. Ils interviennent comme corps de différentes manières : par des aumônes destinées au remboursement des fournisseurs de nourriture et de bois de chauffage aux pauvres; par des souscriptions et un support — cession de terrain, location de maisons à des taux avantageux, prise en charge de la clientèle hébergée — aux institutions d’assistance. Face à celles-ci, ils réservent leurs ressources plus particulièrement aux Sœurs grises de l’Hôpital général. Ils s’impliquent également pour faciliter l’implantation de communautés, dont les Frères de Saint-Gabriel, une communauté qui se consacre à la formation des orphelins. Les Sulpiciens interviennent aussi dans la prolongation de leur charge de pasteur paroissial et comme individu, pour mettre leur fortune personnelle au soulagement de la misère.
Les Sulpiciens comme animateurs culturels
Les Sulpiciens jouent un rôle majeur auprès du grand public montréalais pour développer le goût pour les arts d’inspiration française : musique, chant, beaux-arts et architecture. Leur contribution s’effectue par l’importation d’œuvres artistiques, par des commandes à des artistes français de même que par une incitation d’artistes québécois à leur service à poursuivre leur formation auprès de maîtres français.
Les Sulpiciens sont aussi hommes de lettres, sachant intéresser les Montréalais à leur histoire et, d’une façon plus générale, à la bonne lecture. Chargé de la visite des maisons sulpiciennes en Amérique pour le compte du Supérieur général, Étienne-Michel Faillon laisse en héritage une production historique étonnante : des biographies des religieuses fondatrices d’institutions montréalaises, une histoire générale de la Nouvelle-France jusqu’en 1675, en trois volumes, plusieurs recueils de documents permettant de compléter son œuvre. Par ses écrits, Olivier Maurault, directeur du Collège André-Grasset et aussi recteur de l’Université de Montréal, redonne aussi vie au souvenir de sa communauté.
Enfin, les Sulpiciens contribuent à propager le goût de la lecture parmi le grand public et à l’orienter. Sur ce point, ils se démarquent tout particulièrement en mettant sur pied la première grande bibliothèque francophone. Leur contribution financière, leurs bibliothèques personnelles, des dons de particuliers donnent naissance à une collection qui passe du Cabinet de lecture paroissial, localisé en face du Séminaire de Saint-Sulpice en 1857, à la Bibliothèque Saint-Sulpice du 1700, rue Saint-Denis, qui ouvre ses portes en 1915 — acquise en 2005 par l’Université du Québec à Montréal —. À la suite des difficultés financières rencontrées par les Sulpiciens, l’édifice et ses collections sont achetés par le gouvernement du Québec en 1941. Les bases sont désormais jetées pour la création de la Bibliothèque nationale du Québec, aujourd’hui Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
La mémoire des Sulpiciens
La présente publication est tout à l’honneur des directeurs et de ceux qui y ont collaboré. Elle contribue à redonner vie au patrimoine immobilier de Montréal. Une lecture attentive permettra sûrement au visiteur qui déambule le dimanche après-midi de redécouvrir une face cachée de certains bâtiments devant lesquels il a coutume de passer. Pour les activités moins visibles de la communauté, comme la prédication ou sa présence auprès des congrégations religieuses, les archives que les Sulpiciens préservent soigneusement, en conservent la trace et ne demandent qu’à être consultés. Abondamment citées par les auteurs de l’ouvrage, elles créent un nouvel intérêt pour les archives paroissiales dans leur ensemble, dont il existe maintenant au Québec des inventaires pour certains diocèses.
Gilles Durand
Découvrez un pan de votre histoire qui vous était peut-être inconnu. Louis-Guy Lemieux. Grandes Familles du Québec. Éditions Septentrion. 2006. 161 pages.
Découvrez un pan de votre histoire qui vous était peut-être inconnu.
Louis-Guy Lemieux. Grandes Familles du Québec. Éditions Septentrion. 2006. 161 pages.
 Depuis 2003, le journaliste et passionné de généalogie Louis-Guy Lemieux présente, dans une chronique hebdomadaire estivale publiée dans le journal Le Soleil, les ancêtres dont les descendants forment les grandes familles du Québec. Trente de ces chroniques, enrichies de faits nouveaux, ont été regroupées dans un livre. On y trouve les ancêtres des familles Tremblay, Gagnon, Bouchard, Côté, Fortin, Roy, Pelletier, Lavoie, Gagné, Morin, Ouellet, Bélanger, Lévesque, Girard, Poulin, Simard, Gauthier, Bergeron, Caron, Beaulieu, Dubé, Fournier, Savard, Lachance, Paquet, Lessard, Lapointe, Cloutier, Dufour et Nadeau.
Depuis 2003, le journaliste et passionné de généalogie Louis-Guy Lemieux présente, dans une chronique hebdomadaire estivale publiée dans le journal Le Soleil, les ancêtres dont les descendants forment les grandes familles du Québec. Trente de ces chroniques, enrichies de faits nouveaux, ont été regroupées dans un livre. On y trouve les ancêtres des familles Tremblay, Gagnon, Bouchard, Côté, Fortin, Roy, Pelletier, Lavoie, Gagné, Morin, Ouellet, Bélanger, Lévesque, Girard, Poulin, Simard, Gauthier, Bergeron, Caron, Beaulieu, Dubé, Fournier, Savard, Lachance, Paquet, Lessard, Lapointe, Cloutier, Dufour et Nadeau.
Dans sa préface, la présidente de la Société de généalogie de Québec, Mariette Parent, écrit pertinemment que «c’est en livrant l’histoire et la généalogie de ces valeureux ancêtres qu’ils seront libérés de l’anonymat et demeureront gravés dans la mémoire collective ». Elle ajoute plus loin que: « le grand mérite de cet ouvrage est de donner le goût de faire son histoire personnelle. Par une incursion à l’intérieur de ses propres souvenirs, il devient possible de raviver la fierté de ses origines, de laisser un héritage tangible à ses enfants, et de comprendre l’importance de conserver ses papiers de famille et ses archives personnelles » .
Au fil des pages, Louis-Guy Lemieux alimente en effet notre attachement pour tous ces courageux pionniers venus ici avec, chevillés à l’âme, les espoirs les plus grands. Espoirs réalistes pour quelques-uns d’entre eux puisque cette émigration leur a permis de réaliser des rêves qui, en France, étaient inimaginables. Ce fut le cas par exemple pour Maurice Poulin qui n’aurait jamais pu accéder, en France, à ces postes qui, ici, l’ont auréolé de prestige. Simple domestique lorsqu’il est arrivé en Nouvelle-France, il devint successivement procureur fiscal, juge, procureur du roi.
Tout en saluant le courage de nos ancêtres, Louis-Guy Lemieux montre aussi, pour reprendre l’expression de l’écrivain Marc Levy, que « tout rêve à un prix ». Certains sont morts durant la dure traversée; d’autres, à l’instar de Simon Savard, y ont survécu, mais ont vu leur santé inéluctablement compromise. La vie des premiers ancêtres n’était pas de tout repos. Tout était à construire et avec peu de moyens. Sans compter les procès qui accaparaient leur temps et minaient leur énergie; la Nouvelle-France ayant été, aux dires de plusieurs historiens, « le royaume de la zizanie ». Louis-Guy Lemieux l’illustre lorsqu’il mentionne ce couple, Guillaume Fournier et son épouse Françoise, qui se sont souvent retrouvés devant les tribunaux : « Il semble que l’héritière des Hébert était aussi chicanière que son mari et semblait incapable de vivre sans un ou deux beaux procès, le plus souvent intentés à des membres de sa famille ». Il ajoute, avec cette pointe d’humour qui émaille souvent son texte : « C’est à se demander où Guillaume et Françoise ont trouvé le temps de mettre au monde et d’élever 15 enfants ».
Les tranches de vie de nos ancêtres relatées par l’auteur révèlent des pans de notre histoire aussi diversifiés qu’intéressants. L’un d’eux fut chercheur d’or au Klondike. Un autre, le chirurgien Étienne Bouchard, est aujourd’hui qualifié par bon nombre d’historiens comme étant l’ancêtre de l’assurance-maladie et ce, parce qu’il s’engageait à soigner tous les membres de la famille de 26 notables à raison de 100 sols par année. Une femme, Hélène Desportes, fut la première enfant née d’un colon français et devint sage-femme. Quant à l’ancêtre des Fortin, Julien, dont la fille est une miraculée de sainte Anne, il fut recruté par Robert Giffard, médecin et propriétaire de la seigneurie de Beauport. Ce médecin, venu dans le Perche afin de vanter les mérites de la Nouvelle-France, s’était arrêté à l’auberge du Cheval Blanc qui appartenait au grand-père maternel de Julien. Par ma branche maternelle, je partage cet ancêtre Fortin, dont on dit qu’il était fort généreux, avec Madonna, Céline Dion, Linda Lemay et Louis-Guy Lemieux. C’est l’une des autres caractéristiques de cet ouvrage d’y trouver les figures marquantes parmi la descendance de chacune des 30 grandes familles.
En racontant la vie de nos ancêtres, Louis-Guy Lemieux dévoile souvent des aspects méconnus, mais pourtant relativement courants à l’époque. Il était assez fréquent par exemple que des femmes épousassent des hommes beaucoup plus jeunes. Ce fut le cas de Marie Hourdouille qui a épousé un homme de 16 ans son cadet. Il était courant aussi que des filles du roi signassent plusieurs contrats de mariage, et ce, parfois dans la même journée. Ce fait étonnant s’explique par le climat de précipitation dans lequel les filles devaient choisir un époux. Plusieurs d’entre elles acceptaient d’épouser untel, changeaient d’idée, annulaient leur contrat de mariage et en signaient un autre au plus vite. L’ancêtre des Savard fut éconduit à deux reprises de cette façon.
Devant certaines actions de nos ancêtres, comme celle de Pierre de Lavoye qui, afin de payer ses dettes, a loué la force de travail de ses filles, l’auteur mentionne pertinemment qu’il importe de « voir avec les yeux de l’époque ». Il est nécessaire en effet de resituer les faits dans leur contexte afin d’éviter toute forme de jugements de valeur qui pourraient dénaturer la réalité.
Le texte de Louis-Guy Lemieux est agréablement porté par de nombreuses illustrations et photos : non seulement celles de descendants les plus illustres, mais aussi celles de maisons et de lieux ayant des liens avec nos ancêtres. Ces photos sont autant d’invitations à visiter les endroits où ils ont vécu ou à voir ce qu’eux-mêmes ont vu telles que les chapelles historiques de Saint-Nicolas (Québec) ou celle, construite au XIIe siècle, où fut baptisé l’ancêtre des Beaulieu, en Anjou (France), et qui éblouit par sa beauté.
Les férus de généalogie seront un peu jaloux d’apprendre que des descendants des Cloutier ont eu la chance inouïe de lire une lettre écrite, au XVIIe siècle, de la main de leur ancêtre, dans laquelle elle raconte à ses parents différents aspects de sa vie en Nouvelle-France tels que le pont de glace devant Québec et des Iroquois ayant massacré huit habitants sur la côte de Beaupré. Elle conclut ainsi : « Lorsque nous sommes venus ici, il n’y avait que cinq ou six petites maisons; tout le pays était de grandes forêts pleines de halliers. Maintenant, Québec est une ville et il y a plusieurs villages autour ».
Connaissant toutes les embûches qui se trouvent sur le chemin des généalogistes, l’auteur mentionne certes une erreur dans le nombre des descendants de la famille Dufour mais il s’empresse d’ajouter qu’elle « montre que les recherches généalogiques n’ont jamais de fin et que même les meilleurs peuvent se tromper ». Il est vrai que le passé ne se laisse pas toujours aisément décrypter, même pour les plus rigoureux des chercheurs.
Le sens des mots change au fil des siècles. En relatant l’histoire des ancêtres des Pelletier, Louis-Guy Lemieux le mentionne lorsqu’il écrit que « dans la langue de l’époque, le mot déserteur est synonyme de défricheur » *. Il rappelle aussi que les surnoms de plusieurs de nos ancêtres ont reçu différentes interprétations.**
Ce sont donc des pans de notre histoire fort intéressants qui nous sont révélés dans ce livre ainsi que plusieurs aspects de la mentalité d’une époque dont chaque bribe est précieuse pour qui veut comprendre dans quel contexte ont vécu nos ancêtres.
Sergine Desjardins
Romancière, essayiste et conférencière.
Chroniqueuse à L’Ancêtre, revue de la Société de généalogie de Québec
www.sergine.com
*Les dictionnaires d’Antoine Furetière (1619-1688) sont des sources d’informations fascinantes sur le sens des mots au XVIIe siècle. L’un d’eux, Les mots obsolètes, est en format poche.
**Ceux et celles qui désirent approfondir ce sujet trouveront dans le livre Votre nom et son histoire de Roland Jacob une mine d’informations impressionnante et passionnante sur la signification des noms de familles au Québec. Éd. de l’Homme.
Crédit photo : Les Éditions du Septentrion
Comment se porte la recherche sur le Canada français?
Comment se porte la recherche sur le Canada français?
[La recherche sur le Canada français] « se porte bien, mais elle pourrait se porter mieux » répond le directeur, qui peut compter sur ses doigts le nombre de chercheurs sur la francophonie âgés de moins de 40 ans. « Nous devons intéresser les étudiants au passé des collectivités de langue française du Canada et de l’Amérique et les amener dans des centres de recherche comme le CRCCF » (Bulletin du CRCCF, vol. 10, n° 2, mars 2007).
C’est en ces termes que s’exprime le nouveau directeur du Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) en poste depuis janvier 2007, Yves Frenette. Celui-ci succède à Jean-Pierre Wallot. Il oeuvrait auparavant au Collège universitaire Glendon (Université York) de Toronto. Il prend la barre du Centre de recherche avec plusieurs projets :
- Faire connaître le CRCCF par le biais de partenariats à l’échelle nationale et internationale. « Je pense que cette expertise est exportable. On pourrait très bien penser qu’en Afrique et en Europe, il existe d’autres minorités qui voudraient se doter d’un centre d’archives »;
- Entreprendre et diriger des projets de recherche en partenariat. « Nous avons accumulé énormément de documents depuis 1969 dans le domaine franco-ontarien. Je désire que ce fonds d’archives soit exploité de façon plus systématique »;
- Promouvoir la multiplication des centres d’archives régionaux : « Je ne parle pas d’ouvrir des filiales. Je veux dire qu’il faudrait un endroit dans chaque région de l’Ontario français, où on puisse recueillir des archives » (L’entrevue intégrale avec le directeur Yves Frenette est disponible sur le site Web.
Le nouveau directeur mène plusieurs projets de recherche qu’il dirige, codirige ou auxquels il participe et dont le lecteur trouve ci-dessous les descriptions tirées du site Internet du CRCCF.
Lettres et correspondances dans la diaspora canadienne-française, 1840-1970
Projet de recherche pluridisciplinaire (histoire, littérature et géographie), dirigé par Yves Frenette (Université d’Ottawa, CRCCF) et auquel collaborent Marcel Martel (Université York), Jean Morency (Université de Moncton) et John Willis (Musée canadien de la poste). Ce projet vise à produire une monographie sur la place des correspondances dans l’avènement et l’évolution des communautés de langue française, sur tout le continent. Il s’appuie en partie sur les ressources documentaires du CRCCF (subvention du CRSH).
Vous pouvez consulter la présentation qui accompagnait la conférence de M. Yves Frenette , « Alma Drouin, épistolière, 1912-1918 » [, 475 KB], donnée dans le cadre du colloque «De l’Ancien au Nouveau Monde » organisé par l’équipe du projet Modéliser le changement : les voies du français , le mardi 12 décembre 2006, à l’Université d’Ottawa. Cette conférence porte sur une partie de la correspondance d’Alma Drouin, de Laconia, au New Hampshire, qui vécut au Québec entre 1912 et 1918, d’abord dans divers couvents des sœurs de l’Assomption, sur la rive sud du Saint-Laurent, puis comme pensionnaire à Montréal. Les 169 lettres reçues et envoyées par Alma pendant cette période, la plupart rédigées en anglais, permettent de pénétrer dans l’univers d’une famille franco-américaine du début du XXe siècle, tant dans son vécu que dans ses représentations. Elles permettent aussi d’observer de l’intérieur la constitution d’un réseau épistolaire largement dominé par les femmes, réseau qui se maintiendra pendant 90 ans et qui donnera lieu à la rédaction de plus de 2 000 lettres.
Autres projets d’Yves Frenette, directeur du CRCCF
L’Acadie, du tournant du XVIe siècle au début du troisième millénaire : une brève histoire narrative accompagnée de documents, un projet de livre qui s’adresse à un vaste public (contrat avec les Éditions du GREF – Éditions du Groupe de recherche en études francophones, subvention du Collège universitaire Glendon). Atlas historique de la francophonie nord-américaine, un projet de publication codirigé avec Marc Saint-Hilaire (Université Laval) auquel participent une quarantaine de collaborateurs (subventions de l’Université Laval). Les identités francophones contemporaines en Amérique du Nord, un projet de recherche et plusieurs publications qui en découlent : des études sur le centre et le sud-ouest de l’Ontario, un chapitre de livre sur les immigrants récents de langue française au Canada et un essai fondé sur des entrevues réalisées depuis vingt ans avec des francophones de plusieurs régions d’Amérique du Nord (diverses subventions). La présence française au Brésil , projet en collaboration avec Rosana Barbosa (Saint Mary’s University, Nova Scotia).
Yves Frenette est bien impliqué également dans les activités de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses nouvelles tâches.
Gilles Durand
