Bulletin n°37, décembre 2013
Le vêtement des Filles du Roy
Le vêtement des Filles du Roy
Par Raymonde Fortin,
alias Catherine Dupuis, Fille du Roy
avec l’aimable collaboration de madame Catherine Pinsonneault

Source : Raymonde Fortin |
Le 22 septembre 1663, des barques transportant 36 jeunes femmes, quittent l’Aigle d’Or au large de Québec et accostent sur les rives de la Nouvelle-France. Il en sera ainsi chaque année jusqu’en 1673. Au total, elles seront 764 à remplir une mission royale, celle de prendre mari, fonder famille, bâtir nation.
Mais qu’apportent-elles, ces Filles du Roy ? Quels sont leurs avoirs ? En fait, bien peu de choses : une caissette, une mince dot et leurs vêtements.
Après 111 jours de traversée, confinées dans la sainte-barbe, exposées à des conditions sanitaires très précaires, elles n’en mènent pas large : elles souffrent toutes de carence alimentaire, de faiblesse, traînent poux et tiques ; certaines ont été touchées par la dysenterie, la fièvre et le scorbut. Quant à leurs vêtements, ils sont en piteux état. L’humidité de la sainte-barbe les a rendus poisseux, la moisissure s’est mise de la partie et ils sont plus ou moins en lambeaux. Aussitôt débarquées et prises en charge par madame de La Peltrie, les Ursulines et des dames de bien, elles retrouvent, en plus de la santé, de nouvelles tenues vestimentaires.
En ce milieu du XVIIe siècle, l’habillement de ces femmes venues s’établir en Nouvelle-France est semblable à celui des femmes du commun porté en Hollande, en Flandre, en Espagne et en France. Les tissus sont probablement tous importés car les plus anciens métiers à tisser répertoriés au Québec remonteraient seulement au début du XVIIIe siècle. Parmi ces tissus, les inventaires des biens après décès mentionnent la soie, le coton, le lin, plusieurs toiles d’importation comme la toile de Rouen, de Normandie, de Meslies, de Morlaix, diverses étoffes de laine tels drap, serge, étoffe grossière, étamine, et chanvre.
Quant aux couleurs des vêtements, elles sont peu variées : beaucoup de rouge, de bleu, de gris et un peu de brun; parfois, on retrouve des couleurs plus riches comme le cramoisi, l’aurore (saumon-orangé), bleu azuré, violet, couleur d’or (jaune).
Le costume typique des filles à marier, plus tard nommées Filles du Roy par Marguerite Bourgeoys, comprend :
- Les bas, de coton ou de laine de couleur unie (blanc, beige, gris, brun, rouge, bleu pâle ou foncé) montant aux genoux et maintenus par des jarretières sous les genoux, des liens de laine tissée ou tressée, ou un ruban.
- La chemise, de coton blanc ou grège, de lin fin, moyen ou grossier, très ample et munie de manches droites peu ou pas froncées à l’avant-bras. Encolure près du cou et fendue à l’avant jusqu’à la naissance de la poitrine; des cordonnets permettant de la nouer au cou. À noter qu’à l’époque, il n’y a pas de petite culotte ni pour les femmes, ni pour les hommes.
- Les poches, pochettes de tissu, fendues verticalement et montées sur un ruban noué à la taille, constituent un vêtement en soi, indépendant de la jupe. Ainsi, par mesure d’économie, on ne lave bien souvent que le bas de la jupe souillé et les poches grandement utilisées.
- Le corset, tenant lieu de soutien-gorge, en grosse toile tissée serré, lacé devant et, fait surprenant, assez souple. Le plus souvent muni de bretelles, il doit être ajusté directement sur le corps afin d’en épouser la forme. Deux baleines insérées au niveau du laçage lui permettent de garder sa forme. Le corset étant un sous-vêtement, une femme ne doit pas se présenter vêtue uniquement de son corset, elle doit obligatoirement porter un mantelet par dessus celui-ci.
- La jupe, de coton, de lin ou de laine, longue mais laissant voir le pied. Se porte du mi-mollet à la cheville. Faite de deux panneaux très amples montés sur des cordons, froncée à la taille. Panneau arrière noué au devant et panneau devant noué à l’arrière. De chaque côté, une fente prévue pour accéder aux poches. Parfois, deux jupes superposées et l’hiver, une troisième s’ajoute aux deux premières. On les appelle : la secrète, la friponne et la modeste.
- Le mantelet, le corsage ou la camisole, toujours doublé, ressemble un peu à une veste à l’encolure largement arrondie et s’attache à l’avant avec des agrafes ou un laçage. Il épouse la forme du corps, est ajusté à la taille et prend de l’ampleur sur les hanches. Les manches larges sont froncées derrière l’épaule et parfois à l’avant-bras, elles couvrent toujours le coude.
- La jupe et le mantelet sont confectionnés avec du coton moyen, du lin moyen ou des draps de laine fine. Le mantelet se veut de couleur unie et la jupe peut être de couleur unie ou, peu fréquemment, à larges rayures. Les couleurs des deux vêtements sont coordonnées.
- Le mouchoir de col, fait d’un grand carré plié en diagonale, en coton blanc, se porte noué devant, épinglé en laissant pendre les pointes ou en les insérant à l’intérieur du corsage.
- Le bonnet, ou la cornette, de coton blanc, muni de cordonnets noués sur le dessus de la tête, se porte en tout temps.
- La coiffe, capuchon blanc à deux longues pointes, s’ajoute au bonnet ou à la cornette.
- Le tablier, vêtement de travail de coton ou de lin, blanc, naturel ou de couleur. Froncé à la taille, s’attachant à l’arrière par des cordons. Protège une bonne partie du devant de la jupe, pouvant couvrir les hanches et même une partie des fesses.
- Les chaussures, différentes selon les circonstances et l’endroit. On passe des souliers de cuir à talons plats ou moyens, ouverts sur les côtés, aux sabots et souliers de bœuf.
Voilà donc l’habillement des Filles du Roy qui, une fois nippées, choisissent mari et adoptent ce pays neuf qu’est la Nouvelle-France. Avec les années, la nécessité de s’acclimater, le contact avec les Indiens, la garde-robe des unes et des autres, s’enrichit de nouveaux vêtements pratiques et simples.
NOTE : La reconstitution de l’habillement des Filles du Roy en 2013 a été inspirée de toiles de maîtres hollandais, français, espagnols et flamands tels : Jan Steen, Pieter de Hooch, Johannes Vermeer, Louis Le Nain, Bartolomé Esteban Murillo, David Teniers.
Rouen au temps des migrations des Filles du Roy Splendeur et misère d’une capitale provinciale
Rouen au temps des migrations des Filles du Roy
Splendeur et misère d’une capitale provinciale
Par Gérard Hurpin
Maître de conférences Histoire moderne
Université de Picardie Jules Verne
La période de prospérité
Au XVIIe siècle, Rouen était la troisième ville de France, derrière Paris et Lyon. Sans contredit, la capitale de la Normandie tenait une place très élevée sur l’échiquier européen de quelque point de vue qu’on l’envisage : démographique, économique et culturel ; cela seul suffirait à expliquer qu’elle n’ait pu se tenir à l’écart du grand mouvement de conquête et d’exploration des nouveaux mondes. Les exploits de Cavelier de La Salle, explorateur rouennais de la vallée du Mississipi, en témoignent, mais son épopée ne doit pas faire oublier que des personnages de plus modeste envergure tentèrent, eux aussi, « l’aventure américaine ». Les recherches de M. Charbonneau ont montré que, de 1608 à 1679, quelque 500 personnes quittèrent le territoire de l’actuel département de la Seine-Maritime pour s’établir au Canada 1; parmi elles, des « Filles du Roy ».
Au sujet de ces migrations « seinomarines 2 », nous avons un document capital ; il provient de Colbert lui-même. Il s’agit d’une lettre écrite le 27 février 1670 par ce ministre à l’archevêque de Rouen, François de Harlay de Champvallon. Il se plaignait que les filles tirées de l’hôpital général de Rouen pour s’établir en Nouvelle-France n’avaient pas été assez robustes pour résister au climat de ce pays. Il lui demandait de presser les curés des paroisses aux environs de Rouen de solliciter le départ d’une cinquantaine de jeunes villageoises acceptant de passer dans le Nouveau Monde sous la conduite du sieur Guenet, marchand de Rouen 3. Les travaux des généalogistes viennent confirmer les renseignements contenus dans ce texte.
Lorsqu’un pays est capable de supporter l’exode pacifique de certains de ses habitants, c’est bien évidemment qu’il est en état de trop-plein ; mais comment interpréter les raisons de cet excédent ? Est-ce une suite de la détresse ? Est-ce ce que l’on appelle une migration de misère ? Est-ce au contraire le signe d’une forte vitalité démographique ? ou encore l’expression d’une force psychologique incoercible qui contraint certains êtres, quand les temps y sont favorables, à ne pas se contenter d’un horizon trop étroit et à satisfaire par un départ définitif le goût de la nouveauté et de l’aventure ?
Expansion : tel est le maître mot qui guidera notre propos. Cette forme d’expansion démographique et « civilisationnelle » que manifeste le départ des Filles du Roy doit être rapprochée de celle de la ville de Rouen à l’époque considérée, c’est-à-dire le XVIIe siècle pris dans son ensemble.
C’était un temps de dilatation générale de l’Occident, mais à cette notion d’expansion, il faut apporter un correctif : lorsque commença en 1661 l’administration de Colbert, que l’on peut considérer comme l’un des principaux initiateurs du mouvement qui nous intéresse, cette expansion perdit de sa vigueur tout comme la croissance économique de Rouen. Elle nécessitait pour se soutenir le concours de la puissance d’État.
Pour nous faire une idée de ce qu’était cette ville au milieu du XVIIe siècle, nous avons à notre disposition un très beau plan de 1655, celui de Jacques Gomboust. Au plan proprement dit, ce cartographe a ajouté sur la planche, entre autres ornements, deux vues de Rouen : l’une prise du septentrion (du Mont-Fortin) ; l’autre, de l’orient (de la colline Sainte-Catherine).
Au nord de la Seine, la ville, ses très nombreuses églises et ses bâtiments officiels étaient enserrés par de vieilles murailles dont le tracé est celui des actuels boulevards ; au sud du fleuve (quartier Saint-Sever), l’espace était loin d’être vraiment urbanisé : quelques couvents (dominicaines cloîtrées dites « Emmurées 4 », religieux de Grandmont), de vastes jardins d’agrément, des promenades publiques, enfin : le mail et le cours d’initiatives récentes.
Une vue de Rouen vers 1630, œuvre de Claude de Jongh, tableau conservé au musée des Beaux-Arts de Rouen 5, complète le plan de Gomboust ; il n’a qu’un défaut : le peintre donne une vue exagérément statique de la ville alors qu’elle devait être très animée, forte de 80 000 habitants, ce qui dans l’Europe du temps était exceptionnel. À remarquer sur ce tableau : le pont de pierre, reliant les rives de la Seine, est rompu. La ville, industrieuse pourtant, était hors d’état de le faire réparer et dut se contenter de l’établissement d’un pont de bateaux. Ce pis-aller doit à lui seul nous inquiéter au sujet de l’état des finances municipales, reflet d’une situation économique générale plutôt déprimée à partir de 1630.
Un document un peu tardif, il est vrai, nous apprend que cette ville comptait 112 métiers-jurés 6 (ce que l’on appelle improprement des corporations). Toutes les activités artisanales et pré-industrielles de ce temps-là étaient représentées à Rouen Les plus importantes étaient liées à la production et au commerce des tissus. On estimait à 700 les maîtres-toiliers qui donnaient de l’ouvrage à 3500 ouvriers ; à 600 les marchands-drapiers réunis aux merciers 7 assistés de 400 compagnons. Ces chiffres tout à fait considérables laissent penser qu’à certains égards, Rouen était restée alors une de ces villes drapantes comme l’Europe occidentale en a tant connu dès le milieu du Moyen Âge. On donne à imaginer l’animation qu’entraînait le débit de ces draps et de ces toiles autour de la halle aux toiles et dans la zone portuaire. Ainsi s’explique le nombre très élevé des cabaretiers-aubergistes estimé à 300 8.
Ce qui avait franchement changé depuis le XVIe siècle, ç’avaient été les directions du commerce. Le réseau d’influence économique rouennais avait alors pris une ampleur qui, sans exagération, faisait de cette place ? alors comme aujourd’hui, et l’on songe au commerce des blés ? un emporium mondial. Rouen n’avait cessé de participer à l’expansion européenne outre-mer sans que l’Amérique ait eu une place privilégiée dans ses échanges. D’autres espaces maritimes avaient attiré l’investissement maritime rouennais. Selon les recherches très approfondies de M. Levêque de Pontharouart dans les archives notariales où figurent des contrats maritimes, l’eldorado rouennais avait été au commencement du XVIe siècle non tant l’Amérique que le Maroc, mais les circonstances politiques de la fin de ce siècle avaient beaucoup favorisé Rouen et réorienté les directions de son commerce. La guerre d’indépendance des Provinces-Unies avait amené dès 1576 la ruine d’Anvers qui avait fait jusque là figure de capitale économique européenne 9. Une partie du trafic anversois s’était repliée à Rouen. La Hollande conquérait peu à peu l’écrasante prépondérance économique, maritime et militaire dont elle allait jouir au moins jusqu’à la fin du XVIIe siècle ; elle allait s’exercer sur presque toute l’Europe occidentale. Cela se vérifie parfaitement à Rouen où la direction de l’activité portuaire, dans la première moitié du XVIIe siècle, était tenue en dernière analyse par les correspondants de maisons de commerce néerlandaises 10.
Considérant la capitale de la Normandie du point de vue international, il ne faudrait pas non plus négliger la présence d’Espagnols, très visible à la fin du XVIe siècle. Même si ce chapitre est pour le moment encore obscur et n’a été abordé que sous l’angle culturel et religieux, on a lieu de supposer que des négociants de cette nation débitaient les laines brutes de leur pays dans des comptoirs qu’ils avaient établis à Rouen 11. Certains firent souche dans la région et furent connus sous les noms de Civille, de Saldagne et de Quintanadoine où l’on reconnaît du premier coup d’œil les anthroponymes espagnols de Sevilla, Saldaña et Quintanadueñas. Ces familles étaient venues à Rouen pour leur négoce ; elles ouvrirent encore un peu plus aux Rouennais les horizons des espaces hispaniques, européens et américains. Ces marchands eurent d’ailleurs bientôt fait de se fondre dans la noblesse de robe et, ajoutons-le, d’abreuver la spiritualité normande à la source du mysticisme florissant de leur pays d’origine. Il y eut parmi eux des marranes. On tient pour certain que Pierre Corneille a appris l’espagnol de M. de Chalon, donné comme membre de cette communauté juive ou judaïsante 12.
Cela prouve, à mon avis, l’intensité des échanges commerciaux et des transferts culturels dont Rouen avait été le nœud tout en gardant un puissant substratum pré-industriel accompagné ? on s’en doute, et l’affaire est de conséquence ? d’un prolétariat qu’on appela au XVIIIe siècle « les purins de Rouen », concentré dans l’énorme paroisse Saint-Maclou, sur les rives du Robec où se pressaient trente-trois ateliers de tanneries. C’était, à l’est de la ville, non loin de la Maresquerie où devait s’établir l’hôpital général, un vrai foyer de misère.
Rouen s’essoufle
Pour encadrer une telle masse de population, si diverse et si hétérogène, la ville était administrée par un grand nombre de magistrats dont les plus influents, et de loin, appartenaient à ce que l’on appelait des cours souveraines : le parlement, la chambre des comptes de Normandie, la cour des aides qui connaissait le contentieux fiscal de toute la province, le bureau des finances des trésoriers de France. Il s’y ajoutait de très nombreuses juridictions subalternes : bailliage, vicomté, vicomté de l’eau, juridiction consulaire et plusieurs justices seigneuriales. Le parlement de Rouen avait de loin le pas sur toutes les autres cours de justice. Il se composait de 108 officiers résidant souvent dans les quartiers aristocratiques de l’ouest dans de très beaux hôtels. Il avait juridiction sur toute la Normandie et siégeait dans l’actuel palais de justice. Il avait subi de cuisants échecs politiques qui eurent des suites néfastes à son influence régionale et par suite au dynamisme propre de la ville de Rouen. Qu’il soit permis de les rappeler pour mieux en saisir les conséquences le moment venu.
Depuis 1635, la France, dirigée par Louis XIII et le cardinal de Richelieu, était entrée en guerre contre l’Espagne et l’empire allemand. Pour soutenir un tel conflit, le gouvernement central exigeait sans cesse de la population des efforts inouïs. La monarchie taxa très lourdement la Normandie, province réputée riche ? sans doute à juste titre ? mais la pression fiscale fut portée à un tel point que des émeutes connues sous le nom de révolte des Nu-Pieds agitèrent toutes nos contrées en 1639. Rouen donna le signal de la révolte en haute Normandie. L’émeute commença par les avoués et leurs clercs, puis par les drapiers et les teinturiers suivis par les rentiers qui craignaient la banqueroute de l’État et la perte de leurs créances.
Le parlement, chargé traditionnellement du maintien de l’ordre, ferma d’abord les yeux sur les désordres; quand il eut pris conscience de sa légèreté, il était trop tard, l’émeute était maîtresse de la ville. Richelieu confia la répression des troubles au colonel Gassion et le châtiment des révoltés au chancelier Séguier. Des exécutions eurent lieu ; des personnes compromises dans les troubles gagnèrent l’Angleterre pour échapper aux galères royales si ce n’est à la corde. Les corps constitués furent dissous provisoirement. En punition de sa révolte, Rouen fut soumis à l’amende exorbitante d’un million quatre vingt-cinq mille livres.
Un peu moins de dix ans plus tard, la province fut l’un des théâtres de cette espèce de guerre folle : la Fronde. L’un des chefs de cette révolte nobiliaire était le gouverneur de la province, le duc de Longueville, grand bailli de Rouen. Quand la Fronde se fut achevée dans une débâcle complète, la situation de Rouen était sérieusement compromise. La main pesante, mais pacificatrice de l’absolutisme, s’abattit sur toute la Normandie par l’intermédiaire de ses agents les plus zélés, les intendants, administrateurs nommés et révoqués par le roi, étrangers aux intérêts de coteries qui discréditaient l’ancienne administration. Ce furent des agents brutaux et sourcilleux mais d’une efficacité incomparable : bref, des technocrates, là où avait prévalu jusque là l’administration par les magistrats. Dès février 1650, au nom du tout jeune Louis XIV, le gouvernement central établit comme intendant de Rouen M. de Miromesnil qui y avait déjà exercé les mêmes fonctions concurremment avec Claude Paris et Étienne Pascal, père du philosophe. L’impulsion venait désormais de Paris. Rouen jouissait des bienfaits du retour de l’ordre certes ; mais l’initiative des politiques publiques échappait désormais pour une part à ses notables qui l’avaient jusque-là détenue.
Ira-t-on jusqu’à dire que la vie municipale s’étiolait ? Laissons parler ses responsables, les échevins qui rendaient compte de leur administration tous les trois ans. Sans prétendre établir le total des charges pesant sur la ville, arrêtons-nous aux plus pesantes obligations fiscales telles que les échevins les exposaient. Selon eux, Rouen devait verser de 40 000 écus (environ 120 000 livres 13) destinés à la maison de la reine. La France étant constamment en guerre depuis 1635, il incombait à cette ville de fournir les vêtements des fantassins du roi, ce qui était estimé à 20 000 livres. Les frais de logement des gens de guerre en quartier d’hiver (il n’existait pas alors de casernes) s’élevaient annuellement à 42 000 livres. Il s’y ajoutait des charges exceptionnelles lorsque les campagnes militaires devenaient particulièrement onéreuses lors d’un siège comme ceux d’Arras (1654) et de Valenciennes (1656) ; un effort supplémentaire de 20 000 livres était alors exigé.
La nature même de la constitution monarchique mettait la ville dans l’obligation d’organiser des réjouissances publiques dans toutes les circonstances où la gloire du monarque, la continuité de la dynastie et la stabilité de l’État étaient en cause ; ce fut le cas à l’occasion du sacre du roi (1654), de la célébration des victoires de ses armes, de la paix avec l’Angleterre (9 décembre 1655), de l’exaltation du pape Alexandre VII (1655), du mariage de Louis XIV (1659) et de la naissance du dauphin. Ces dépenses extraordinaires grevaient le budget des équipements collectifs qu’il fallait sacrifier. Il est vrai que les gens du temps ne concevaient pas forcément l’emploi des deniers publics du point de vue utilitaire qui est maintenant le nôtre : le spectacle de la gloire et la splendeur, le répit que les fêtes apportaient, venaient rompre la monotonie des vies grises des populations et l’on ne pouvait concevoir de ville sans une succession de fêtes religieuses et civiles. Cela avait sans doute au moins autant de prix que l’utile. C’est ainsi que Rouen devait remettre à plus tard les réparations d’installations pourtant indispensables à la vie même de ses habitants. Une des fontaines publiques, celle de Saint-Léger amenant l’eau de consommation, s’était tarie faute d’entretien de certaines canalisations. Les fossés n’étaient pas ou mal curés ; toutes sortes d’ordures les comblaient peu à peu aggravant ainsi le risque de peste qui éclata bien des fois sous forme épidémique jusqu’ en 1668. Les murailles de la ville ? c’était d’ailleurs le fait d’en être ceint qui définissait l’espace urbain ? étaient échancrées de brèches par lesquelles passaient vagabonds et contrebandiers. Ces ouvertures, suites de la négligence et de l’impécuniosité, présentaient des dangers certains pour la sécurité publique. En effet, le pays fut constamment en guerre de 1635 à 1659 : un coup de main audacieux de l’ennemi pouvait mettre Rouen en sa puissance 14. Quant à l’introduction de marchandises de contrebande, c’était autant de perdu pour les caisses des octrois.
Ne pouvant financer tous les grands travaux d’infrastructure, les échevins paraient au plus pressé : sauver ce qui pouvait l’être des équipements portuaires et commerciaux. Ils firent consolider et repaver le quai et procédèrent sur la rive sud du fleuve à la réfection du talus et de la chaussée des Emmurées. On répara les halles, « les plus belles de France » disait-on, et l’on fit refaire les ponts enjambant la rivière du Robec dont les eaux arrosaient les quartiers les plus populeux et les plus industrieux vers l’est de la ville. L’essentiel des dépenses était consacré à l’entretien du pont de bateaux qui avait remplacé le pont de pierre dont l’une des arches s’était effondrée depuis longtemps.
La dette courante de la ville de Rouen était estimée à 90 000 livres, la contraignant à l’augmentation des droits d’entrée des marchandises pénétrant dans la cité. Cette élévation n’allait pas de soi ; il fallait en obtenir l’autorisation royale. Les droits que percevait la vicomté de l’eau 15 sur le trafic fluvial furent augmentés ainsi que les octrois sur les cires et les sucres ; si la charge était onéreuse, somme toute, Rouen se tirait avantageusement de cette affaire alors que les octrois de toutes les autres villes de la Normandie avaient été doublés dans le même temps 16. Ces exorbitantes augmentations d’impôts durent vraisemblablement ralentir le mouvement commercial et freiner la consommation populaire. Vers 1660, les finances municipales étaient arrivées à un tel point de délabrement que les échevins durent prendre sur leurs deniers personnels pour parer aux dépenses les plus urgentes de la ville 17.
Le pouvoir central, constatant ces inextricables embarras, les attribua à l’incurie et à l’impéritie des autorités municipales dont il rogna peu à peu les pouvoirs jusqu’à ce que, par un lent mais constant processus centralisateur, l’édit de 1692 eut complètement étouffé les très anciennes libertés des villes et eut fait des fonctions de maires de simples offices transmissibles et vénaux.
Il est vrai que les forces institutionnelles d’encadrement semblaient débordées depuis 1645 environ par la montée de la pauvreté, inséparable de la présence d’un important prolétariat, sensible à tous les aléas d’une conjoncture économique plutôt défavorable et de circonstances politiques intérieures franchement désastreuses lors même que la France multipliait ses victoires, tant sur ses frontières que sur le territoire des ennemis, espagnols et impériaux.
L’impossibilité de régler la lancinante question de la pauvreté avait sans doute contribué à l’affaiblissement du pouvoir municipal. En vain a-t-on cherché une date précise où le public changea d’attitude envers les pauvres. Les chronologies s’enchevêtrent et les faits repérables vont à l’encontre de ce que les textes normatifs énoncent… de là les bévues de Foucault et de ses émules qui n’ont guère le sens du document et ont bâti des « modèles » sur des stocks documentaires manifestement insuffisants d’où l’on écartait avec soin tout ce qui aurait pu aller à l’encontre de la « théorie ».
Il est vrai que la réglementation rouennaise concernant les pauvres se précipita à partir de 1645 et cette tendance persista jusqu’en 1661, comme si les forces d’encadrement avaient été débordées par une certaine forme de montée de la pauvreté pendant cette quinzaine d’années 18. Le 17 décembre 1645 le bureau des pauvres – institution municipale – publia une ordonnance en forme de règlement touchant l’instruction, la nourriture et l’entretien des filles indigentes de sept à dix-sept ans menacées par les périls où les exposait la mendicité de leurs parents. Il était disposé que ces filles seraient enfermées et instruites dans la maison et enclos de la Maresquerie « et qui a esté fait exprès pour renfermer les pauvres ». (C’était l’endroit même d’où, selon Colbert dans le texte dont on a fait mention ci-dessus, on avait tiré des jeunes filles fragiles pour les conduire au Canada). Cette réclusion aurait lieu à partir de Pâques 1646. Les jeunes filles devraient y être instruites de leurs devoirs religieux, y apprendre un métier et, du produit de leur travail, se former un pécule. S’il restait des places disponibles, on admettrait à la demande des parents, les filles d’ouvriers pauvres. Cette seule clause laisse songeur devant l’interprétation qu’on donne, à la suite de Foucault, de cette affaire de « renfermement » qui a fait florès dans les années 70 où l’on faisait si abusivement servir « les sciences humaines » à des causes militantes. Si ces maisons avaient été les bagnes que la doxa « historiquement correcte » contraint d’y voir ? d’ailleurs par une cascade d’anachronismes manifestes ? comment expliquer qu’en cas de besoin, les nécessiteux se fussent précipités à leur porte ?
Si l’on en juge par le règlement du 1er mai 1646, l’ordinaire des pensionnaires, pour n’être pas somptueux, n’était pas, sur le papier tout au moins, inférieur à ce que demandent les besoins élémentaires de la nutrition : 750 grammes de pain par jour, 100 g. de viande de bœuf, un potage au dîner, un œuf et une pomme et quelques mesures de bière. Les pensionnaires étaient assurés du service mensuel de chirurgiens.
En 1654, les garçons furent admis au logis de la Maresquerie. Des collectes où les notables furent requis d’ouvrir généreusement leurs bourses permettaient d’ouvrir des ateliers de terrassements pour donner un salaire minimum aux hommes et aux garçons en cas de crise économique et de chômage.
En contrepartie de cette réglementation, il était entendu que les nécessiteux étrangers à la ville seraient chassés avec la dernière sévérité, sauf cas très particuliers (pèlerins véritables munis d’une attestation de leur évêque, étrangers victimes de circonstances extraordinaires, comme les Britanniques chassés par la guerre civile). On peut simplement se demander si cette mesure a été sérieusement appliquée dans une ville dont les murs étaient percés de brèches… Toute cette réglementation fut reprise dans l’arrêt du parlement de Rouen du 23 avril 1654 où l’on voit le véritable acte de fondation du système de secours rouennais d’Ancien Régime. Il s’y ajoutait un effort de scolarisation qui peut paraître bien timide, mais ce sont souvent par de faibles commencements que prennent consistance les fondations les plus durables. Un chanoine établissait, par acte du 10 septembre 1658, deux écoles de pauvres chargées de leur enseigner la doctrine chrétienne, la lecture et l’écriture.
À la fin du XVIIe siècle, l’historien Masseville estimait que l’hôpital de Rouen nourrissait plus de deux mille pauvres et que la dépense s’y élevait à plus de cent mille francs chaque année 19.
On assistait donc, dans ces décennies cruciales du milieu du XVIIe siècle, à une prise de conscience anxieuse par les notables de ce que l’on appela deux cents ans plus tard « la question sociale » ou encore « l’extension du paupérisme ». À la vérité, l’ampleur de la vague de misère du milieu du XVIIe siècle a dû prendre de court les milieux dirigeants de la ville qui, pour éviter son extension indéfinie, durent faire appel aux forces d’un absolutisme en plein essor lors de la prise du pouvoir par Louis XIV en 1661. C’est sous un tel signe qu’il faut placer l’intéressante expérience des Filles du Roy : ce que la ville, à bout de souffle, ne put faire, le roi l’exécuta dans une brillante opération qui tenait un peu de ce que nous appelons « la communication ». Au roi, la charge de cinquante jeunes rouennaises, à la ville…le reste…
La remise en ordre absolutiste
Fixer son attention trop longtemps sur la misère sociale fausse la représentation qu’on peut se faire de cette vaste société qu’on appelle « une ville ». Misère et splendeur y coexistent, mais dans des rapports qui varient avec le temps. La justesse de notre esquisse exige que l’on s’attache à ce qui continuait de faire de Rouen une très grande ville de France.
Sur le plan de Gomboust, mentionné plus haut, figure une discrète mention : « maison de M. de Corneille ». Repoussons l’idée de ramener le génie aux circonstances qui l’ont vu naître, se former et grandir, mais l’on ne peut s’empêcher de penser que si Rouen n’avait été la deuxième ou troisième ville du royaume, si elle n’avait été le lieu de commerce des idées autant que des biens, le poète l’aurait fui dès ses jeunes années. Or, il n’en fut rien. Il ne s’installa définitivement à Paris qu’en 1662, à cinquante-six ans. Bourgeois obscur qui ne dut son élévation qu’à son génie, admettons qu’il eut une dette envers sa ville où régnait une forte effervescence « culturelle » au temps de sa jeunesse, à tout le moins 20. En 1658, Molière et sa troupe se produisirent à Rouen, dans un jeu de paume aménagé en théâtre durant l’été ; cette ville fut la dernière étape avant la sédentarisation du grand comique à Paris. Ce fut lors du passage de la troupe de Molière à Rouen que Pierre Corneille écrivit l’épître et les célèbres stances à Marquise Duparc, l’une des plus belles des comédiennes de son temps.
Les deux frères, Pierre et Thomas Corneille, avaient été instruits au collège des jésuites, somme toute de création récente : 1593. Cet établissement comptait deux mille élèves peu de temps après sa fondation. Plus tard, pour les hautes études théologiques et la formation de futurs prêtres, M. de Harlay, archevêque, fit venir les pères de l’Oratoire en 1641. On donne à penser le nombre de bons lettrés que tous ces religieux formaient tout au moins dans la bourgeoisie et dans la noblesse 21.
La réforme catholique, consécutive au concile de Trente, avait amené l’établissement dans la ville de Rouen de nouvelles communautés de religieux : jésuites, oratoriens déjà mentionnés, mais aussi feuillants, récollets, minimes et capucins ; de religieuses : carmélites et de bénédictines du Saint-Sacrement dont la mystique Catherine de Bar. La ferveur religieuse catholique se manifestait par les œuvres de la charité certes, mais il nous faut aussi prendre en compte le grand souffle artistique qui accompagna cette « invasion mystique ». À la question : « Au XVIIe siècle, les peintres occupèrent-ils à Rouen une place importante ? », M. Denis Lavalle répond : « Tout concourut à la leur donner : une clientèle aisée et érudite, un milieu artistique organisé et aux solides traditions, un lien toujours maintenu avec Paris 22. » En effet, le nombre d’artistes peintres était si considérable dans la capitale normande qu’ils se constituèrent en confrérie de Saint-Luc en 1662. L’exposition « La peinture d’inspiration religieuse à Rouen au temps de Pierre Corneille » (1984) a permis à MM. François Bergot et Pierre Rosenberg d’isoler un foyer de création pictural rouennais actif depuis les derniers feux du maniérisme, avec le mystérieux Saint-Igny, jusqu’au pur classicisme de Jouvenet. On n’aura garde d’oublier l’élégant Nicolas Colombel, artiste dans la pure tradition de Poussin, né à Sotteville-lès-Rouen en 1644, mort à Paris en 1717, dont une exposition du musée des Beaux-Arts de Rouen a retracé la carrière en 2012. On pourrait allonger la liste de ces peintres actifs dans ce foyer rouennais ; on y placerait Daniel Hallé (1614-1675), Pierre Le Tellier, Adrien Sacquépée… La plupart de ces maîtres travaillèrent principalement pour les maisons religieuses qui firent ainsi preuve d’un mécénat très averti.
La ville fut aussi redevable à ces religieux d’un vigoureux essor intellectuel, tardif, à la vérité, en comparaison de certaines villes comme Caen. Les ecclésiastiques y tinrent une place d’honneur si l’on excepte le très érudit magistrat Bigot de Monville dont on consulte toujours les savants écrits. Le chapitre cathédral de Rouen ouvrit sa bibliothèque aux savants vers 1650 et, sous l’impulsion de la réforme de Saint-Maur, les bénédictins de Saint-Ouen confièrent à Dom Pommeraye vers 1660 la rédaction de l’histoire de leur abbaye à laquelle il ajouta celle de la cathédrale et des conciles de Rouen dans d’imposants volumes in-folio. La première histoire méthodique de Rouen est due à François Farin ; elle parut en 1668 23. Il est donc indiscutable que l’action de l’Église avait permis dans une très large mesure ce bouillonnement. Le magistère moral et intellectuel des religieux et des dévots suscitait par réaction des libres penseurs et des poètes libertins : « le plaisant abbé de Bois-Robert » et « le gros Saint-Amand », ce Falstaff normand, pilier des bouges rouennais. À l’autre extrémité de l’éventail des sensibilités et des mentalités, Rouen, plutôt vers la fin du siècle, nourrit un foyer de jansénisme, ce rigorisme catholique. Cette doctrine, ou plutôt cette manière de vivre le catholicisme, avait eu pour promoteur dans la région le magistrat Thomas du Fossé, étroitement lié à Port-Royal. La figure la plus haute du jansénisme rouennais pourrait bien avoir été celle du prêtre Nicolas Le Tourneux (1640-1686), né d’une famille pauvre de la paroisse Saint-Vivien, plus tard vicaire de Saint-Étienne-des-Tonneliers qui s’était fait quelque temps instituteur d’enfants pauvres. Du libertinage de rabelaisiens tardifs à l’austérité sublime des jansénistes : telles étaient les couleurs extrêmes de ce qu’on aurait appelé jadis « le portrait moral » d’une ville.
Rouen conservait une avance certaine dans la production et le commerce du livre, ce media majeur des temps modernes. C’était au XVIIe siècle le troisième centre d’impression de la France ; c’était aussi un foyer du commerce international du livre où parvenaient des impressions des Pays-Bas, d’Allemagne rhénane et d’Angleterre. Cependant, vers 1660, les heures de grande gloire et d’expansion conquérante de la librairie rouennaise étaient déjà loin : où était le temps d’un grand éditeur comme Raphaël Du Petit Val 24 ? Les trente ans qui vont de 1670 à 1700 virent une crise de la production et du commerce des livres. En effet, la librairie fut l’objet de règlements qui entravèrent la production, le commerce et l’importation d’imprimés. Rouen résista et s’adapta à ces nouvelles dispositions en contournant, fût-ce par la fraude, ce qu’elles avaient d’excessivement rigoureux, mais une résistance n’est jamais vraiment un élan. De grandes maisons subsistèrent pourtant : Berthelin, Maurry, Machuel, Cailloué, Viret, Besongne, Lucas, Lallemant, Oursel, Behourt, Dumesnil, et Vaultier, mais elles étaient sur la défensive et ne parvenaient plus à tenir leur rang que par d’habiles procédés de consolidation, grâce aussi à l’existence d’un clientèle captive comme celle des cours de justice et des ecclésiastiques, tous grands consommateurs de papier imprimé. L’édition rouennaise vécut en partie désormais de la production de livres prohibés portant mention trompeuse d’une impression étrangère. Elle demeura aussi l’intermédiaire culturel clandestin entre la France et l’Europe du nord, majoritairement protestante et désormais à la pointe des audaces intellectuelles ; mais, répétons-le, Rouen n’y participa plus que clandestinement.
Reprenant notre question du commencement : quelle était la physionomie de Rouen au moment des départs des Filles du Roy, période qui coïncide à très peu près à la prise du pouvoir par Louis XIV, en 1661 ? ? Les réponses qu’on peut apporter à cette question sont simples.
Conclusion
Rouen est la deuxième ou troisième ville du royaume. À considérer les choses dans leur grande masse, elle demeure la grande ville drapante qu’elle n’avait cessé d’être depuis cinq siècles. Elle est et restera l’avant-port de Paris, la fortune de l’une et l’autre villes étant indissolublement liée par le trafic de la Seine. Après une très longue période de prospérité à tous points de vue, que l’on pourrait appeler : « l’ère Pierre Corneille », Rouen s’essouffle. La politique générale n’est pas étrangère à ce ralentissement. La création de l’État absolutiste par Richelieu et de ses successeurs eut un prix très élevé que Rouen et la Normandie, contrée réputée riche, ont dû payer au prix fort : stagnation de l’investissement public et privé, étouffement des libertés provinciales, mise sous surveillance des élites régionales, contraction spirituelle et culturelle et, jusqu’à un point que l’on ne saurait préciser, exacerbation de la pauvreté. La contrepartie de la remise en ordre absolutiste n’est pas mince cependant : moins exubérante, moins créative, la capitale rouennaise, placée désormais sous la conduite ferme d’intendants de justice, police et finances nommés et révoqués par le roi, profitait d’un ordre et d’une régularité que le foisonnement baroque du premier XVIIe siècle ne lui avait pas permis de connaître. Les Filles du Roy en furent indiscutablement les bénéficiaires.
__________
Notes
1. H. Charbonneau et al., Naissance d’une population. Les Français établis au Canada au XVIIe siècle, INED, Presses universitaires de Montréal, PUF, 1987.
2. Néologisme : « relatif au département de la Seine-Maritime ».
3. Lettres, instructions et mémoires de Colbert éditées par Pierre Clément, Paris, 1861-1882, t. III, 2e partie, p. 476.
4. Il y avait sur ces terres basses un couvent de dominicaines cloîtrées que le peuple appelait « Emmurées ».
5. Cette œuvre est reproduite dans Philippe Priol, Pierre Corneille en son temps, Archives départementales de la Seine-Maritime, s.d. [2006]. Ce livre contient une photographie de la gravure de Rouen par Merian (vers 1620) et des détails du plan de Gomboust, difficile à photographier utilement dans son intégralité.
6. Gérard Hurpin, L’intendance de Rouen en 1698, Paris, 1985, p. 291-293. Le document date de 1727.
7. Merciers s’entend des marchands en général.
8. Le document présente une difficulté de lecture ; on pourrait lire 700 à la place de 300 ; 700 me paraît exagéré.
9. Une grande partie des travaux de M. Levêque de Pontharouart reste malheureusement inédite et demeure à l’état de manuscrits.
10. Ed. van Birma, « Quelques remarques sur les relations commerciales du passé entre Rouen et la Hollande », Congrès du millénaire de la Normandie (911-1911) ? Compte rendu des travaux, Rouen, 1912, p. 79-101. Le grand vaisseau qui figure sur le tableau de de Jongh bat fièrement pavillon hollandais.
11. Arlette Doublet, Catalogue du fonds ancien espagnol et portugais de la bibliothèque municipale de Rouen, 1479-1700, Presses universitaires de Rouen, s. d. [1970].
12. Préface de Raymond Marcus au livre précédemment cité, p. 10.
13. On n’a aucun moyen de comparer la valeur de l’argent aux époques anciennes et à la nôtre. Pour s’en faire une idée, on admettra que l’ouvrier gagnait 10 sous par jour, soit la moitié d’une livre. Cela suffira à se représenter l’énormité des charges qui pesaient sur Rouen et par suite les rigueurs fiscales du milieu du XVIIe siècle.
14. Les attaques de ville par surprise devenaient rares au XVIIe siècle. Cependant, en 1673, des conspirateurs faillirent se rendre maîtres de Quillebeuf, sur l’estuaire de la Seine en pleine guerre de Hollande.
15. La vicomté de l’eau de Rouen avait juridiction sur la Seine et sur les marchandises apportées par ce fleuve.
16. Comptes rendus des échevins de Rouen (1409-1701), édition de J. Félix, Rouen, 1890, t. II, p. 193.
17. Ibid., p. 233.
18. Dans les développements qui suivent, je me trouve en complète concordance de vues avec la contribution du professeur Hecketsweiler. J’aurais volontiers retranché les lignes que je consacre ici au traitement de la pauvreté si cette suppression n’avait pas nui à la cohérence de mon propos. Les textes les plus importants sur ce sujet ont été publiés par le docteur G. Panel, Documents concernant les pauvres de Rouen, Rouen, Société de l’Histoire de Normandie, Rouen et Paris, 1917-1919, 3 tomes.
19. Cité dans Gérard Hurpin, L’intendance de Rouen en 1698, Paris, 1985, p. 39.
20. On a souvent mentionné que la Normandie avait produit au XVIIe siècle un nombre exceptionnel d’écrivains.
21. Sur ce point, il faut combattre un préjugé trop souvent répandu : jésuites et oratoriens n’avaient nullement l’intention de réserver l’enseignement humaniste à une étroite frange favorisée par l’argent ou la naissance. L’impossibilité économique de dispenser cet enseignement à toutes les classes de la société fut la seule cause de cette « sélection » de fait et non de principe.
22. La peinture d’inspiration religieuse à Rouen au temps de Pierre Corneille, Rouen, 1984, p. 46.
23. Thomas Joille, La naissance d’une histoire locale : l’historiographie rouennaise de la fin de l’humanisme à l’aube des Lumières, mémoire de maîtrise sous la direction de MM. Gallet et Hurpin, Université de Picardie Jules-Verne, 1998-1999. Travaill très prometteur qui mériterait publication.
24. Jean-Dominique Mellot, L’édition rouennaise et ses marchés (vers 1600-vers 1730), Paris, 1998.
Le Couvent de la Providence de La Rochelle et les Filles du Roy
Le Couvent de la Providence de La Rochelle et les Filles du Roy
Par Romain Belleau
Chercheur en généalogie,
membre associé de la CFQLMC et
membre de la Société d’Histoire des Filles du Roy.
L’histoire de la fondation du couvent des Filles de Saint-Joseph de La Rochelle n’est guère différente de celles de multiples autres sociétés, congrégations séculières (ou régulières) créées à la même époque pour des motifs sociaux : aide aux pauvres, aux mendiants, aux malades, ici aux orphelines, entreprises dévotes.
Dans un article publié en 1874 par la Société des Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis, on lit : « C’est à la Congrégation de Saint-Joseph, notamment aux maisons de Paris et de La Rochelle, que le gouvernement civilisateur de Louis XIV, désireux d’établir ses colonies sur des bases solides, demandait les jeunes filles « sages et pieuses » qu’il envoyait au Canada, à la Guadeloupe, etc., pour en faire des mères de famille modèles. Grâce à cette conception élevée, nos anciennes possessions françaises, le Canada surtout, conservent, même encore aujourd’hui, une pureté de mœurs et de foi qu’on chercherait vainement parmi nous, et qui rappellent les merveilleuses traditions du grand siècle. »
On oubliera l’idéologie exprimée dans ces lignes pour retenir qu’à l’époque, 1874, il est connu que le couvent des Filles de Saint-Joseph de la Providence de La Rochelle a eu affaire avec les Filles et Femmes envoyées en Nouvelle-France pour se marier. Malheureusement, comme dans de trop nombreux documents du XIXe siècle, il manque toujours les sources et les références des informations données.
Au moyen d’actes notariés trouvés, je vais évoquer brièvement l’histoire, l’évolution du couvent de La Rochelle; j’attirerai l’attention sur les liens entre le couvent et diverses personnalités, et j’évoquerai le rapport du couvent avec les Filles du Roy.
L’histoire du Couvent de la Providence
Marie Delpech de l’Étang crée à Bordeaux la communauté séculière de la Société de Saint-Joseph pour le gouvernement des filles orphelines, et une maison pour soulager la misère des orphelines pauvres et abandonnées; la communauté est « érigée » par l’évêque de Bordeaux en 1638. En mai 1641, une maison est créée à Paris. D’autres établissements suivent à Rouen, Agen, Toulouse, Limoges…
En 1658, l’évêque de La Rochelle autorise Isabeau de Mauriet, compagne de la première heure de Marie Delpech et chargée depuis quelques années de la maison de Bordeaux, à s’établir à La Rochelle… Isabeau de Mauriet vient à La Rochelle et loge chez Olivier Papineau, conseiller du roi, juge, garde royal de la monnaie de cette ville. Le 9 décembre 1658, une première femme se présente pour être engagée comme novice, Marie Gonet. Elle est la fille d’un avocat en parlement de La Rochelle.
Août 1661, la « Société des Filles de Saint-Joseph de La Rochelle » établies pour l’institution et éducation des filles orphelines » reçoit ses lettres patentes du roi, c’est-à-dire l’écrit, émanant du roi, qui établit un privilège ou un droit. La Communauté peut accepter toutes sortes de legs pieux, donations et testaments qui seraient faits en sa faveur, acheter les biens et possessions nécessaires pour sa subsistance, nourriture et « entretiennement ». En février 1662, la maison de La Rochelle est reconnue comme maison de fondation royale, “étant de grande nécessité”; ses buts sont « empêcher la perversion des filles abandonnées par la mort de leurs parents, et donner moyen aux filles religionnaires de travailler à leur conversion ». Le premier acte (notarié) dans lequel j’ai trouvé l’appellation « couvent des filles Saint-Joseph de la Providence de la maison de La Rochelle » date d’octobre 1662.
En septembre 1663, la communauté demande de pouvoir prononcer les trois vœux : pauvreté, chasteté et obéissance, plus un quatrième: instruire, nourrir et élever les pauvres orphelines en gardant clôture. La demande est acceptée en août 1664. Les sœurs deviennent donc cloîtrées. Les actes notariés qui concernent le couvent indiquent bien à partir de ce moment qu’ils sont passés « au parloir et grille du monastère et couvent des dames religieuses de la congrégation Saint-Joseph établie en cette ville » (19 juin 1665). Seule la supérieure, Isabeau de Mauriet reste séculière pour s’occuper des autres maisons des Filles de Saint-Joseph.
L’année 1664 voit la publication de L’Institut et la Règle ou Constitutions des Filles de la Trinité dites religieuses de la Congrégation de Saint-Joseph, instituées pour l’éducation des filles orphelines dans la ville de La Rochelle. Le décret portant confirmation des statuts de la nouvelle communauté sous le nom de Filles de Saint-Joseph et de la Providence date de juillet 1664. Il est indiqué qu’on recevra les enfants d’une condition aisée dans un pensionnat. On donnera [aux jeunes filles orphelines], avec « une éducation conforme à leur état, tout le nécessaire pour la vie et le vêtement, sans jamais les faire souffrir, et si elles-mêmes doivent contribuer à leur entretien, que ce ne soit nullement par un travail qui excède leurs forces et ruine leur santé ». À cet objectif s’ajoute celui de recevoir et « travailler à la persévérance des nouvelles catholiques», jeunes filles protestantes tirées de leur famille et destinées à être élevées dans la foi catholique.
Isabeau de Mauriet achète d’abord un modeste domaine, « une petite maison consistant en quatre petites chambres sur terre, sans plancher, couverte en thuilles, et ses appartenances, cour et appentis et deux petits jardins situés en la rue de la Vieille Fontaine, paroisse de Cougnes ». En août 1659, elle achète une partie d’une cour rue Vieille Fontaine d’Alexandre Landaz, « écuyer seigneur du Bignon conseiller du roy en ses conseils, lieutenant général enquesteur et commissaire examinateur au siege presidial » de La Rochelle. Est aussi témoin à ces actes Olivier Papineau, chez qui Isabeau de Mauriet a logé en 1658.
En janvier 1665, la communauté acquiert « trois petites maisons se joignant consistant chacune en une chambre basse et une haute et un petit jardin au derrière ainsi que le tout se poursuit et comporte de présent situées en cette ville près de la vieille fontaine rue de Clerambaud dans le fief Saint-Louis ». L’établissement touche à la maison et jardin d’Alexandre Landaz et d’un autre côté aux maison et jardin de Pierre Mousnier, procureur au dit siège présidial.
Je reviendrai sur ces noms.
En avril 1666, Isabelle de Mauriet signe avec un maître maçon et tailleur de pierres de la ville un marché pour achever les « murailles » de l’enclos du couvent des orphelines. Elle reçoit également des rentes perpétuelles en faveur de la communauté.
On peut donc suivre au moyen d’actes notariés l’établissement de la communauté dans la ville et la présence des mots « de la Providence », pas toujours attachés au nom du couvent.
En 1667, le couvent se composerait donc au moins de la petite maison achetée en 1659 comportant quatre chambres, et des trois maisons achetées en 1665, de chacune deux chambres.
Les sœurs.
On connaît aussi par les minutes notariales les noms des nouvelles religieuses, que leurs familles dotent et pour lesquelles elles assurent la pension le temps du noviciat.
Nous pouvons énumérer les sœurs qui ont certainement accueilli les Filles qu’on trouvera au couvent en 1667 :
- Bénigne de Gommis ou de Gommier entrée en 1665 à l’âge de 28 ans,
- Louise de Lachaussée, entrée aussi en 1665, à l’âge de 27 ans,
- Françoise Mallet, toujours en 1665, à 28 ans,
- Françoise Ballon, en 1666, âgée de 15 ans,
- Catherine de Lachaussée, âgée de 40 ans, en 1666, sœur de Louise entrée l’année précédente.
- Il y a également Jeanne de Villepontoux, originaire du Périgord, entrée au couvent en 1656, auquel cas elle serait d’abord entrée au couvent de Bordeaux, et qui en 1671, rédige son testament et prononce ses vœux. Elle précise dans son testament que sa mère s’est remariée avec un gentilhomme de la religion prétendue réformée, un protestant, dont elle ne sait pas le nom, qu’elle a fait part à sa mère de son intention d’entrer au couvent, qu’elle n’en a pas eu de nouvelles, et que sa mère n’a pas payé sa pension pendant toutes ces années.
- Il y a aussi Marie Ranconnet, majeure, de religion protestante et qui a abjuré.
- Il y a Marie Tharay, 15 ans, toujours en 1666.
- Et il y en aura d’autres bien sûr plus tard.
Le couvent et les Filles du Roy.
En décembre 1666, un édit royal ordonne que les communautés établies depuis trente ans représentent les lettres patentes en vertu desquelles elles ont été établies aux Juges des lieux. Le roi a observé que depuis quelques années se sont créées des « maisons régulières et des communautés » sans lettres patentes « par la connivence ou négligence, écrit-il, que nos Officiers ont apportées à faire garder lesdites ordonnances ». L’édit est enregistré au Parlement de Paris le 31 mars 1667.
En septembre 1667 le lieutenant général, c’est-à-dire Alexandre de Landaz, commence l’enquête. La communauté possède bien les fameuses lettres patentes exigées; les religieuses comparaissent mais refusent de donner à autre que l’évêque l’état de leurs revenus et charges. En octobre le roi demande donc à l’évêque de procéder à l’enquête. Cet évêque s’appelle Monseigneur de Laval, ce serait un cousin du vicaire apostolique pour l’Amérique du Nord, et futur premier évêque de Québec, lorsque l’évêché sera créé en 1674. Monseigneur de Laval s’acquitte de sa tâche en visitant le couvent et il établit un rapport dont on trouve des éléments dans des livres.
Le rapport conclut que l’établissement est pauvre, qu’il s’y trouve « soixante filles desquelles quinze ont fait leur abjuration de l’hérésie, et les autres de pauvres petites filles orphelines tirées la plupart de leurs parents religionnaires qui les faisaient aller au presche et les instruisaient dans la religion prétendue réformée, six autres que les curés des paroisses ont tirées des mains de leurs parents qui menaient une vie scandaleuse afin d’empescher leur perte, et quatre demoiselles bien sages [que les sœurs] ont receues depuis peu par les mains des Pères de l’Oratoire et Jésuites pour les instruire et eslever avec cinq autres dans le Canada au premier embarquement ».
On n’a aucune liste des pensionnaires du couvent.
La visite de l’évêque aurait eu lieu le 3 novembre. Si le couvent héberge à cette date des filles en attente de partir pour le Canada, elles ne se sont pas embarquées en 1667, elles sont certainement parties en 1668.
Tout se passe bien pour le couvent. Son statut et ses lettres patentes sont enregistrés par le Parlement en janvier 1668. En 1671, à la mort de Marie Delpech de l’Etang, Isabeau de Mauriet devient supérieure de l’établissement parisien, et une de ses nièces sans doute supérieure de celui de La Rochelle. Le 25 août 1672, dix sœurs prononcent leurs vœux solennels.
Je ne parle pas de l’histoire du couvent après 1673, le temps manque et déborde du sujet de mon intervention et des commémorations.
Aujourd’hui, une partie des bâtiments du couvent de La Rochelle est occupée par l’établissement scolaire Fénelon-Notre-Dame.
Liens avec Bordeaux, La Rochelle…
J’ai signalé la présence de certaines personnes lors des contrats et actes divers signés par les religieuses du Couvent Saint-Joseph. J’y reviens pour signaler ou évoquer des liens.
Les évêques de Laval : liens familiaux, et bien sûr liens « de religion ».
Marie Delpech : elle fonde la congrégation des Filles de Saint-Joseph, et son nom apparaît aussi dans le registre du Couvent du Refuge à Rouen, où deux Filles du Roy ont d’ailleurs été recueillies avant leur départ de France. En 1645 entre dans le Couvent du Refuge une fille dont le nom n’est pas donné dans le registre, amenée par force par la marquise de Senesé; elle avait d’abord été mise dans la maison du Refuge de Paris; elle ne reste pas longtemps au couvent de Rouen; le registre indique : « Lon la renvoiee peu apres a paris avec madamoiselle de letant quy est de St joseph de Paris ». Par ailleurs, Marie Delpech, comme me l’a indiqué Jean-Paul Macouin, est témoin au mariage de Catherine Desnaguets, épouse du sieur Petit, l’accompagnatrice des Filles de 1667 qui signent un acte de protestation contre les conditions qui leur sont faites à leur arrivée à Dieppe. Catherine Desnaguets, orpheline, est pensionnaire du Couvent de Paris.
Olivier Papineau : il est conseiller du roi, juge, garde royal de la monnaie de La Rochelle. Le 9 décembre 1658, lorsqu’elle vient pour la première fois à La Rochelle, Isabelle Mauriet loge chez lui. Il est témoin à certains actes passés par la Communauté. En février 1668, il reconnaît avoir prêté son nom à Isabelle Mauriet en août 1659 dans les actes concernant « la maison et couvent et appartenances des dites religieuses », il l’a toujours fait, écrit-il, pour les religieuses; il n’a aucune prétention « en l’étendue du dit emplacement en fond rente ou autrement ».
Alexandre Landaz : le 21 août 1659, Alexandre Landaz, « écuyer seigneur du Bignon conseiller du roy en ses conseils, lieutenant général enquesteur et commissaire examinateur au siege presidial » de La Rochelle, cède à Elizabeau (sic) Mauriet « supérieure des filles orphelines de Saint-Joseph » de cette ville une partie d’une cour rue Vieille Fontaine. Je rappelle que les maisons acquises par la communauté en janvier 1665 jouxtent celle d’Alexandre Landaz, et celle de Pierre Mousnier. Enfin c’est lui, Landaz, qui est chargé en 1667 de l’enquête sur le couvent. Mais il agit là dans le cadre de ses fonctions.
Pierre Mousnier : Procureur au siège présidial de La Rochelle. Voisin du couvent.
Jacques Mousnier : il est le frère de Pierre et il apparaît dans plusieurs actes liés à la Nouvelle-France.
Il est marchand et bourgeois de la ville de La Rochelle. Le 18 juin 1652, au nom de Jérôme Le Royer de la Dauversière, il engage trois ouvriers pour Montréal. Je rappelle que Le Royer de la Dauversière de La Flèche est l’initiateur de Ville-Marie (Montréal). Et je note que ces engagements ne sont pas relevés par Gervais Carpin dans son ouvrage Le réseau du Canada. En mai et juin 1659, c’est dans la maison de Jacques Mousnier que Jeanne Mance engage des serviteurs et ouvriers pour Ville-Marie (Montréal). C’est à lui qu’elle emprunte l’argent nécessaire pour le transport des engagés, somme qu’elle remboursera en 1664. Elle loge chez lui. En juin Jacques Mousnier engage lui-même des ouvriers pour Ville-Marie ou Québec.
Ce que je veux faire remarquer, c’est l’existence d’une sorte de petit réseau lié à la Nouvelle-France. Un historien a parlé d’un réseau de cette sorte autour de Jeanne Mance, réseau fait tout à la fois de ramifications familiales : les cousins évêques de Laval, les Mousnier; de fidélités politiques, ici peut-être des liens déterminés par la situation sociale : Papineau à la Monnaie, Landaz lieutenant du présidial, les Mousnier l’un procureur, l’autre marchand; et d’entreprises dévotes : Mousnier, Le Royer de la Dauversière pour Ville-Marie, madame de l’Etang., Jeanne Mance…, les Jésuites, les prêtres de l’Oratoire fondés par Olier, curé de Saint-Sulpice…
Il m’a paru intéressant de souligner ces « proximités »…
Nous connaissons l’histoire du couvent : il est pris dans un réseau de personnes et personnalités liées de manière directe ou indirecte à l’aventure de la Nouvelle-France; en 1667 des Filles y sont logées avant leur embarquement pour le Canada; elles ont été confiées au couvent par les Jésuites et les Pères de l’Oratoire. Mais nous n’avons pas de renseignements sur la présence de Filles du Roy à un autre moment.
C’est peu ? Peut-être.
Mais tout ce qui permet de mieux connaître l’histoire des Filles du Roy est utile.
Sources
Archives départementales de Charente-Maritime, greffes Combaud, Demontreau, Michelon, Raffet.
Le Saint-Siège, le Québec et l’Amérique française : Les archives vaticanes, pistes et défis
Le Saint-Siège, le Québec et l’Amérique française : Les archives vaticanes, pistes et défis,
sous la direction de Martin Pâquet, Matteo Sanfilippo, Jean-Philippe Warren, Collection
Culture française d’Amérique, Québec, Presses de l’Université Laval, 2013, 308 p.
Par Gilles Durand

Source : Presses de l’Université Laval |
Les chercheurs disposent maintenant d’une nouvelle publication sur les archives vaticanes. Les dix-sept textes qu’elle renferme, avec introduction par Dominique Deslandres* et les codirecteurs, représentent les communications faites par dix-huit spécialistes des relations Vatican-Québec-Amérique française lors d’un colloque tenu à Rome en mai 2011. Martin Pâquet*, Matteo Sanfilippo* et Jean-Philippe Warren* ont agi comme codirecteurs de l’ouvrage.
L’état des archives vaticanes et des instruments de recherche
Comme la première partie du sous-titre « les archives vaticanes » l’annonce, l’ouvrage jette un nouvel éclairage sur ces documents en tenant compte des travaux réalisés au cours des quinze dernières années. Il présente un tableau des administrations du gouvernement pontifical qui encadrent la pratique religieuse sur le continent nord-américain, telles les congrégations romaines de la Propagation de la foi, du Saint-Office (Giovanni Pizzorusso*) et des Affaires ecclésiastiques extraordinaires (Matteo Sanfilippo*). Il montre l’utilité incontestable des documents qu’elles ont produits et signale leurs principales caractéristiques, marquées par la complexité, l’abondance et la variété. Cependant, la grande quantité d’informations qu’ils renferment ne doit pas faire négliger pour autant leur complément au niveau des archives locales, celles des réseaux transnationaux, des diocèses, des institutions d’enseignement, etc. (Gilles Routhier*) sans oublier les correspondances laïques et ecclésiastiques (Yves Frenette*). La publication tient compte également de l’état actuel des instruments de recherche, inventaires et guides préparés au cours des dernières années avec le support des nouvelles technologies qui se développent sans cesse (Pierre Hurtubise*).
L’encadrement du catholicisme par la hiérarchie à la lumière du contexte socio-politique
L’ouvrage porte bien le sous-titre « pistes et défis » apparaissant en 2e partie. Sur une période de près de quatre siècles, il aborde un large éventail de sujets à explorer : le lien entre la conversion au catholicisme au 17e siècle – en passant par les mariages mixtes entre personnes de différentes croyances – et l’acquisition de la citoyenneté française (Dominique Deslandres*); la révision de la prétendue servitude de Mgr Briand (1760-1766) envers la couronne britannique à la lumière de la conviction généralement partagée dans le monde atlantique qu’il fallait tirer du conquérant britannique « le maximum d’avantages avec le minimum de risques » (Luca Codignola*, p. 125); la vision idéalisée de la Ville Sainte, gardienne des « reliques des temps anciens, traces de l’origine d’un christianisme pur à partir de laquelle l’Église canadienne doit s’inventer un devenir (Ollivier Hubert*, p. 145) »; la primauté donnée à la mission spirituelle sur la langue et la culture des croyants, par la hiérarchie catholique dans l’organisation et l’encadrement de la pratique religieuse (Simon Jolivet*, Phyllis E. LeBlanc*, Michel Bock*); le collège canadien mis sur pied à Rome pour accueillir le clergé venu parfaire sa formation (Jules Racine St-Jacques*); la création des diocèses et celle des régions administratives du Québec qui ont gommé le cadre diocésain dans le contexte de la Révolution tranquille (Fernand Harvey*); enfin les honneurs attribués par Rome à des Québécois entre 1850 et 1929 et les facteurs pris en considération, personnalités ayant fait preuve de munificence envers l’Église, « personnalités illustres … [du] monde de la politique ou de la haute diplomatie » (Jean-Philippe Warren*, p. 291).
Pistes de recherche pour mieux connaître l’inscription du Québec dans l’espace religieux atlantique
L’encadrement et le développement du catholicisme en territoire québécois et nord-américain doivent être regardés dans une perspective atlantique, la résolution des conflits devant tenir compte selon les époques de la présence de trois métropoles, Rome, Paris et Londres, et de communautés de culture, de langue et de religion différentes (Gérard Fabre*, Roberto Perin*). Les questions doivent aussi être abordées avec une vision universaliste, en ayant à l’esprit que les dicastères du Saint-Siège interviennent parfois sur des questions similaires à l’échelle du monde. Les chercheurs doivent de même prendre en compte les hommes eux-mêmes faisant partie de la hiérarchie ecclésiastique, leurs convictions profondes, les consulteurs convoqués, pour expliquer les décisions prises. En conclusion, nous pouvons affirmer sans ambages que l’ensemble des sujets traités constituent autant de sources d’inspiration et de stimulation pour poursuivre et approfondir les recherches sur les relations qui se sont établies entre les catholiques sur le continent nord-américain en passant par les trois métropoles qui sont intervenues à un moment ou l’autre, Rome, Paris et Londres. C’est un défi que les archives vaticanes permettent de relever (Laura Pettinaroli*).
Voir aussi une présentation de l’ouvrage par l’éditeur Les Presses de l’Université Laval
*Table des matières
| Introduction | |
|
5 |
| Chapitre 1 – Archives | |
|
Favoriser et faciliter l’accès aux documents d’intérêt canadien dans les archives du Saint-Siège
|
17 |
|
Les archives des Congrégations romaines de la Propagande et du Saint-Office et l’histoire de la Nouvelle-France et du Québec (XVIIe-XXe siècle)
|
27 |
|
Les Archives Secrètes Vaticanes, celles de la Congrégation des Affaires Extraordinaires et l’histoire de la Nouvelle-France et du Québec (XVIIe-XXe siècles)
|
49 |
|
Tous les chemins mènent-ils encore à Rome?
|
67 |
|
Chapitre 2 – Rencontres |
|
|
L’histoire socio-religieuse de l’Amérique française du XVIIe siècle dans les archives romaines
|
89 |
|
Quoi de neuf sur la prétendue servitude de Monseigneur Briand (1760 à 1766)?
|
109 |
|
Aux origines de la romanisation de l’imaginaire religieux du Québec :
|
133 |
|
Quelques réflexions sur les échanges épistolaires entre l’Amérique française et le Saint-Siège, 1840-1920
|
147 |
|
Mens sana in corpore ecclesiastico sano : le collège canadien à Rome, 1888-1939
|
157 |
|
Rome, plaque tournante pour le Canada
|
175 |
| Chapitre 3 – Enjeux | |
|
Rome, les relations internationales et la question nationale avant la Seconde Guerre mondiale
|
185 |
|
Rome, Dublin, Ottawa : les catholiques canadiens et les réseaux outre-Atlantique
|
197 |
|
Sur les questions de relations de pouvoir : le cas de l’Acadie des Maritimes, 1878-1936
|
215 |
|
La création des diocèses catholiques et la structuration des régions Du Québec, 1836-1973
|
233 |
|
Le Vatican et l’ACFEO au moment du Règlement XVII
|
257 |
|
Porter sa croix
|
277 |
| Chapitre 4 – Prospectives | |
|
Pour une histoire vaticane de l’Amérique française ouverte et comparatiste :
|
297 |
La guerre des Canadiens 1757-1763, Québec, Septentrion, 2013, par Jacques Mathieu et Sophie Imbeault
La guerre des Canadiens 1757-1763, Québec, Septentrion, 2013,
par Jacques Mathieu et Sophie Imbeault
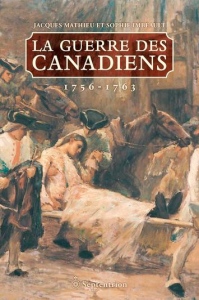
La guerre des Canadiens 1757-1763 |
Bref résumé de la publication par Jacques Mathieu
Motivation de départ :
L’agacement provoqué par les perceptions :
- guerre entre les Français et les Anglais
- alors qu’en fait 40% des morts sont des Canadiens
Constat général :
L’effrayant avec les guerres c’est qu’elles deviennent des statistiques ou des symboles qui font oublier les drames individuels, l’horreur concrète et quotidienne vécue par les personnes. Dans le cas présent, jusqu’à maintenant, les perceptions font surtout valoir :
- la bataille des Plaines
- la mort des deux généraux
- l’abandon de la France
Or, il n’y a rien de cela dans ce livre
Objectifs
- Rejoindre et identifier les personnes de la société civile (hommes, femmes et enfants) touchées par la mort, la mobilité, la dévastation;
- Mettre un nom sur ces victimes et sur leur situation familiale;
- Dégager les éléments de contexte qui ont sans doute engendré des émotions très grandes;
Constats
- Des lendemains dévastateurs (Côte-du-Sud : de 30 décès par mois à l’hiver 1759 à 72 à l’hiver 1760); Exemple Haïti
- Le deuxième drame acadien : en décembre 1757 et janvier 1758, sur les 2000 Acadiens qui ont réussi à éviter la déportation et se sont réfugiés à Québec, 500 meurent d’une épidémie de petite vérole;
- Des résistances locales et des curés récalcitrants;
- Les pertes financières dues au retard et à la diminution des remboursements de la monnaie de carte;
- Nobles, officiers et administrateurs : choisir une patrie et dénicher de nouvelles voies d’avenir;
- Destin des petites gens : veuves, prisonniers, expatriés;
- Au total 15 000 personnes sur environ 65 000 ont été touchées par la mort, la mobilité ou la dévastation : 1 personne sur 4;
- Des cas particuliers : M…, G…, D…
Conclusion
Les Canadiens se sont battus pour leurs biens, leurs familles et leurs valeurs. Il n’y a pas de honte à avoir été battu par une armée 4 fois plus nombreuse.
Un défi
Ce livre n’a pas la prétention de tout révéler.
Les familles de vos ancêtres l’ont vécue comment cette guerre ?
Réappropriez-vous l’histoire de Longueuil et prenez plaisir à découvrir les hauts faits de ceux qui vous ont précédés !
Réappropriez-vous l’histoire de Longueuil et
prenez plaisir à découvrir les hauts faits de ceux qui vous ont précédés !
Par Cyrille de Germain
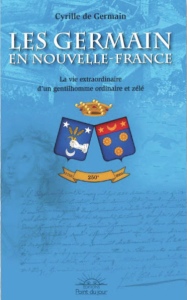
Source : Éditions Point du jour
|
En 2012, la ville de Longueuil fêtait le 355e anniversaire de sa fondation. Sept ans plus tôt, en 2005, elle affirmait son identité en adoptant solennellement les armes de son fondateur, Charles Le Moyne.
Cette même année, était commémoré également le 250e anniversaire du mariage, en 1755, de Joseph de Germain avec Agnès Le Moyne de Longueuil. De cette union est issu l’auteur du présent ouvrage, Français venu au Québec rechercher ses racines familiales, ce qui lui valut de faire une gratifiante découverte, celle de descendre en ligne directe des barons de Longueuil.
Quand il n’était pas en campagne, Joseph de Germain séjournait au château de Longueuil. Il porta haut et fort les couleurs de Longueuil en devenant, comme ingénieur, cosignataire de l’édification du célèbre fort Carillon, dont la fameuse victoire du même nom est à l’origine du fleurdelisé, l’actuel drapeau du Québec.
Cet ouvrage repose en grande partie sur la correspondance inédite, écrite par Joseph de Germain à son père. Ces lettres sont un témoignage sincère, émouvant, de la vie quotidienne d’un officier montpelliérain au Canada ; elles montrent, entre autres, comment le chevalier de Germain participa aux victoires de Carillon et du fort William-Henry qui serviront de cadre au fameux livre Le dernier des Mohicans.
|
Adresse de l’éditeur : 521, rang Point-du-Jour Sud L’Assomption (Québec) CANADA J5W 1H 6 Tél. 450 589-6371 Courriel : yogingras@videotron.ca
|
Pour les amateurs français, voici les coordonnées de l’auteur : cyrilledegermain@hotmail.fr Prix de l’ouvrage : 20 euros port compris |
P.S. : Dans le volume n° 9 de Ces villes et villages de France, …berceau de l’Amérique française (Provence-Alpes-Côte d’Azur – Languedoc-Roussillon) publié par la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC), Joseph de Germain, en tant que personnage majeur, fait l’objet d’une notice bien développée à la page 90.
Mot du coprésident Denis Racine
Mot du coprésident
La Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC) a pour mission de connaître, faire connaître et de commémorer les lieux de la mémoire commune franco-québécoise.
À cet égard, l’année 2013 a été importante par le nombre et l’ampleur des commémorations qu’elle a organisées ou auxquelles elle s’est associée.
Pour souligner les 250 ans du Traité de Paris, une table ronde a été organisée à Montréal, suivie le lendemain d’une conférence de l’historien Denis Vaugeois à Québec. La section française a repris le flambeau et a offert un colloque qui a eu lieu les 20, 21 et 22 novembre dernier, à Paris, sous le thème « Paris 1763-Paris 1783 : d’un traité à l’autre – Un monde atlantique nouveau ». Plus de vingt-six communications y ont été présentées devant plus de 150 participants avec le précieux concours des Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, de la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives du ministère de la Défense et des Archives Nationales de France.
À l’été, le 350e anniversaire du départ de France et de l’arrivée en Nouvelle-France du premier contingent des Filles du Roy a été rappelé par une collaboration entre la Commission et la Société d’histoire des Filles du Roy. La Commission a pris en charge l’organisation des activités en France par des cérémonies à Paris, Rouen, Dieppe et La Rochelle entre le 6 et le 16 juin.
2013 marquait aussi le 50e anniversaire du décès de la grande chanteuse Édith Piaf. Un mini-colloque a été présenté à Québec le 10 novembre en collaboration avec les Régionales Seigneuries-La Capitale et de Québec de l’Association Québec-France et la Société historique de Québec et qui a réuni plus de 135 participants.
L’écrivain Louis Hémon, auteur du célèbre roman Maria Chapdeleine, disparaissait en 1913. Afin de commémorer le centenaire de sa mort, la Commission a participé à Paris à deux rencontres-tables rondes, l’une au Lycée Louis-le-Grand, alma mater de l’auteur et l’autre à la Bibliothèque Gaston-Miron, les 26 et 27 mars dernier. Puis elle a parrainé le colloque Louis Hémon, pluriel et exemplaire ? Ruptures, succès, oublis, initiative de la Société historique de Montréal, tenu aux Archives nationales à Montréal, les 31 octobre et 1er novembre.
Les activités de la Commission ne se sont pas arrêtées avec la présentation d’évènements de commémoration. Nous avons procédé le 10 octobre dernier, simultanément à Paris et à Québec, dans le cadre du congrès annuel de la Société des musées du Québec, au lancement du portail Musée de l’Amérique française, fruit de la collaboration de 40 musées de France et de 15 du Québec et présentant plus de 850 objets-témoins de l’Amérique française.
L’année 2014 s’inscrira dans la continuité. Ainsi, en avril prochain, la section française organise à Paris, un colloque concernant la participation des Québécois à la Première Guerre mondiale. D’autres activités souligneront le centenaire de naissance de Félix Leclerc, le 350e anniversaire de la fondation de la paroisse Notre-Dame de Québec et de la publication de l’ouvrage de Pierre Boucher, Histoire véritable et naturelle des mœurs et productions du pays de la Nouvelle-France.
Nous vous invitons donc à consulter notre site internet afin d’avoir plus de détails sur nos activités passées et à venir.
En terminant, nous profitons de l’occasion pour souhaiter à tous les membres et amis de la Commission, de Joyeuses Fêtes ainsi qu’une Nouvelle Année remplie de joie, de bonheur et de santé.
DENIS RACINE
Bulletin n°37, décembre 2013
Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC)
1. Vie de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC) et des partenaires
- Mot du coprésident Denis Racine
- Compte rendu de l’assemblée générale de la section québécoise de la CFQLMC tenue le 27 septembre 2013
- La lettre d’information de décembre 2013 de la section française de la CFQLMC
- Denis Racine, AIG et coprésident Québec de la CFQLMC, rappelle l’intérêt des médailles comme témoins de nos origines françaises
2a. Dossier « Les Filles du Roy » de la CFQLMC
- Voir « le bouton » Les Filles du Roy sur le site de la CFQLMC
- « 350 ans plus tard – Les Filles du Roy remettent ça » par Christian Rioux, Le Devoir, 7 juin 2013
- « Les Filles du Roy (1) – « Nous ne serions pas là sans elles », par Christian Rioux, Le Devoir, 5 août 2013
- « Les Filles du Roy (2) – Ni saintes, ni guidounes », par Christian Rioux, Le Devoir, 6 août 2013
- « Les Filles du Roy (3) – Les mères de la nation? », par Christian Rioux, Le Devoir, 7 août 2013
- « Hommage aux mères de la nation québécoise – L’arrivée des premières Filles du roi en Nouvelle-France désormais gravée dans la mémoire collective », Communiqué du ministère de la Culture et des Communications, 7 août 2013
- Texte de Romain Belleau sur « Les Filles du roi » publié dans la Revue française de généalogie, no 206, juin-juillet 2013
- Voir aussi la rubrique Histoire ci-dessous
2b. Autres grands dossiers de la CFQLMC
- Un nouveau portail pour connaître les traces matérielles de la présence française sur le continent nord-américain au temps de la Nouvelle-France
- L’année 2015 commémorera le 350e anniversaire de l’arrivée du régiment de Carignan-Salières au Canada
3. Prix, reconnaissances et distinctions
- Francine Lelièvre, vice-présidente de la CFQLMC, lauréate du « Prix Carrière 2013 » remis par la Société des musées québécois
- Madeleine Juneau reçoit le prix Gérard-Morisset 2013 pour son engagement sans faille envers le patrimoine culturel
- Le prix de l’Assemblée nationale 2013 décerné à l’atlas La francophonie nord-américaine, dirigé par Yves Frenette, Étienne Rivard et Marc St-Hilaire
• Voir aussi le compte rendu de l’ouvrage dans Mémoires vives, no 36, juin 2013 - Denys Delâge reçoit le prix Gérard-Parizeau 2013 pour ses travaux sur l’histoire des autochtones de la Nouvelle-France et du Québec
- Bernard Andrès : un contributeur émérite à la connaissance et à la mise en valeur de la littérature canadienne-française, par Valérie Martin
4. Expositions, colloques, conférences et activités publiques
- Exposition « La colonie [de Cartier-Roberval] retrouvée : un nouveau pan d’histoire révélé », présentée jusqu’au 27 septembre 2015 au Musée de l’Amérique francophone
- « Révélations. L’art pour comprendre le monde : Révélations artistiques, symboliques et historiques. ». Exposition d’une centaine d’œuvres tirées de la collection du Séminaire de Québec, présentée au Musée de l’Amérique francophone jusqu’au 15 mars 2015, dans le cadre du 350e anniversaire du Séminaire
- « Manger ensemble » : Exposition virtuelle, préparée par le Musée de la civilisation, livrant des informations sur les aliments, les coutumes et l’apport des Amérindiens, des Français, etc. au patrimoine alimentaire des Québécois
- « C’est notre histoire – Premières Nations et Inuit du XXIe siècle » : Exposition permanente de synthèse et de référence, au Musée de la civilisation
- Exposition « Une célébration de l’art animalier – La Collection David M.-Lank », présentée jusqu’au printemps 2014 à la Bibliothèque des livres rares et des collections spéciales de l’Université de Montréal
- Congrès quinquennal de la Société généalogique canadienne-française sur le thème « Le Conseil souverain – 100 ans de gouvernance en Nouvelle-France », tenu les 11 et 12 octobre 2013, par Gilles Durand
- Journée d’études sur « La recherche sur le régime seigneurial, d’hier à demain », Université de Sherbrooke, 14 mars 2014, 8 h 30. Dans le but de faire le point sur les recherches actuelles et futures sur le régime seigneurial au Québec
- VIe Journées d’histoire : pêche, grande pêche et bruits de guerre – Hommage à Charles de La Morandière ». Appel à communication avant le 31 janvier 2014 pour le colloque qui se tiendra à Granville les 26 et 27 septembre 2014
- L’importance du voyage de de Gaulle au Québec en avril 1960 : conférence par Robert Trudel à Sherbrooke devant les membres de la régionale de Québec-France le 15 septembre 2013, par Gilles Durand
5. Commémoration, généalogie et toponymie
- Colloque Marie Guyard de l’Incarnation « Quatre siècles de regards sur Marie Guyard », tenu à Tours et à Solesmes les 13 et 14 mai 2013 : Actes, avec introduction par Françoise Deroy-Pineau, accessibles sur le site Internet de Touraine-Canada
- Québec s’est rappelé Piaf au Musée de la civilisation et au Théâtre Petit Champlain le 10 novembre 2013, par Michel Dufresne
- Colloque « Louis Hémon, pluriel et exemplaire? », les 31 octobre et 1er novembre 2013 au Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), par Gilles Durand
- Colloque académique sur le Royal 22e Régiment à l’occasion de son centenaire de naissance, les 17 et 18 octobre 2013, au Collège militaire royal de Saint-Jean, par Gilles Durand
- Fichier Origine : Des pionniers de l’Auvergne, de la Champagne et de la ville de Paris font leur entrée dans la base de données, par Marcel Fournier, coordonnateur
- La grande et les petites histoires [au petit écran], par Emmanuelle Plante
- Évolution génomique inattendue en 400 ans d’histoire canadienne-française, dans Université de Montréal Nouvelles, 8 octobre 2013
- La Commission de toponymie du Québec rappelle :
• le centenaire du Royal 22e Régiment mis sur pied en 1914
• le 100e anniversaire du décès de l’écrivain-journaliste français Louis Hémon, survenu le 8 juillet 1913
6. Archéologie et patrimoine
- Patrimoine – Québec joue de prudence avec la nouvelle loi, par Frédérique Doyon, Le Devoir, 26 octobre 2013
- De nouvelles désignations en marge du 350e anniversaire de la première séance du Conseil souverain de la Nouvelle-France tenue le 18 septembre 1663
- À l’occasion du centenaire de son décès survenu le 8 juillet 1913, Louis Hémon est désigné personnage historique par le ministre de la Culture et des Communications
- La ministre de la Capitale-Nationale annonce un investissement de 20 millions pour la renaissance des Nouvelles-Casernes
- Archéologie : À la recherche du vaisseau perdu au large de Lévis [en novembre 1759] Journal Forum, Université de Montréal, 11 novembre 2013
7. Muséologie
- Portail numérique Mémoires – Amérique française : pour connaître les traces matérielles de la Nouvelle-France sur le continent nord-américain
• Voir aussi Rubrique 1. Vie de la Commission - Les musées McCord et Stewart annoncent leur regroupement sous l’appellation Musée McCord Stewart
8. Histoire – Les Filles du Roy à l’honneur
- La condition d’orphelin(e) en France au XVIIe siècle, par Monique Pontault
- Rouen au temps des migrations des Filles du Roy –Splendeur et misère d’une capitale provinciale, par Gérard Hurpin
- Le Couvent de la Providence de La Rochelle et les Filles du Roy, par Romain Belleau
- Histoire de Jeanne Chevalier, par Janine Arsène-Larue
- Le vêtement des Filles du Roy, par Raymonde Fortin
9. Tourisme culturel
- Un nouveau guide touristique pour découvrir Québec sur application mobile originale
- Ces villes et villages de France, …berceau de l’Amérique française, sous la direction de CFQLMC et de l’Association France-Québec, Collection de douze livres régionaux sous la dir. de Janine Giraud-Héraud et Gilbert Pilleul (Saint-Canadet, LDMC-Publication [terprov-quebec@wanadoo.fr – ], 2008- . Onze livres sont parus à date, le dernier est prévu pour janvier 2014. Michèle Marcadier a signé le compte rendu du 5e et avant-dernier ouvrage paru sur la Bretagne
10. Suggestions de lecture
- La coopération franco-québécoise hier, aujourd’hui, demain – Actes du colloque 2011, sous la coordination de Gilbert Pilleul et Adrien Leroux, compte rendu par Gilles Durand
- CFQLMC, Les textes marquants des relations franco-québécoises (1961-2011), sous la direction de André Dorval, Gilles Durand, Gaston Harvey, Bertrand Juneau et Robert Trudel, Québec, Éditions MultiMondes, 2011, 228 p., compte rendu par Louise Beaudoin
- Archives et musées : Le théâtre du patrimoine (France-Canada), sous la direction de Yves Bergeron et de Vanessa Ferey, Collection Orientations et méthodes, Paris, CTHS, 384 p.
- Le Saint-Siège, le Québec et l’Amérique française – Les archives vaticanes, pistes et défis, sous la direction de Martin Pâquet, Matteo Sanfilippo et Jean-Philippe Warren, Collection « Culture française d’Amérique », CEFAN, Québec, Presses de l’Université Laval, 2013, 306 p., compte rendu par Gilles Durand
- Notre-Dame de Québec : 350 ans à faire l’histoire (1664-2014), Cahier virtuel du journal Le Soleil du mardi 26 novembre 2013, 8 p.
- Retrouver des cousins canadiens – Un rameau de la France en Amérique, par Marcel Fournier, Paris, Archives et culture, 2013, 80 p.
- « Émigration champenoise haut-marnaise vers la Nouvelle-France québécoise (1608-1763) », par Romain Belleau, (dans Les Cahiers haut-marnais, no 266-267, 2013, p. 13-255), présentation par Charles Guené
- Les plus beaux arbres généalogiques par Myriam Provence, Emmanuel de Boos et Jérôme Pecnard, Paris, Les Arènes, 2006, 160 p., accompagné d’un supplément Le petit guide à l’usage des généalogistes, 13 p. Compte rendu par Gilles Durand à paraître dans la revue L’Ancêtre de la Société de généalogie de Québec, no 305.
• Voir aussi le site de l’éditeur - 1763. Le traité de Paris bouleverse l’Amérique, sous la direction de Sophie Imbeault, Denis Vaugeois et Laurent Veyssière, Québec, Septentrion, 2013, 456 p., présentation par l’éditeur
- Le mythe de Napoléon au Canada français, par Serge Joyal, Montréal, Del Busso éditeur, 2013, 576 p., présentation par l’éditeur
- La Guerre des Canadiens 1756-1763, par Jacques Mathieu et Sophie Imbeault, Québec, Éditions Septentrion, 2013, 280 p., bref résumé par Jacques Mathieu.
• Voir aussi la présentation de l’éditeur de même qu’un compte rendu par Gilles Durand à paraître dans le prochain numéro 116 (décembre 2013) de la revue Cap-aux-Diamants. - Vivre la Conquête, tome 1 – À travers plus de 25 parcours individuels, sous la direction de Gaston Deschênes et Denis Vaugeois, Québec, Septentrion, 2013, 264 p.
- Un continent en partage. Cinq siècles de rencontres entre Amérindiens et Français, sous la direction de Gilles Havard et de Mickaël Augeron, Paris, Les Indes Savantes, 2013, 644 p.
- Samuel de Champlain : Espion en Amérique (1598-1603), Texte en français moderne établi, annoté et présenté par Éric Thierry, Québec, Septentrion, 2013, 224 p., présentation de l’ouvrage sur le site de l’éditeur
• Voir aussi - Les Germain en Nouvelle-France [l’histoire de Longueuil], compte rendu de l’auteur Cyrille de Germain
- Une famille, un village, un pays, par Rodolphe Gagnon, Québec, Éditions GID, 2013, 240 p., compte rendu par Françoise Deroy-Pineau
- Cap-aux-Diamants : la revue d’histoire du Québec, compte rendu par Gilles Durand des deux derniers numéros parus,
• no 114 (Conseil souverain et Filles du Roy),
• no 115 (Traité de Paris) - Continuité : Le magazine du patrimoine au Québec, no 138, automne 2013 : numéro consacré aux paysages patrimoniaux
- Sources et limites du pouvoir des officiers de milice dans les campagnes canadiennes sous le régime français (1705-1765), par Marc-Antoine Boudriau, mémoire de maîtrise en histoire, Université du Québec à Montréal, accessible sur Internet
- La France en Amérique du Nord et en outre mer, par Alain Ripaux, préface de Henri Réthoré, ancien Ambassadeur, ancien Consul général de France à Québec, Editions Visualia
