Bulletin n°38, juin 2014
Lacorne Saint-Luc (1711-1784), un survivant
Lacorne Saint-Luc (1711-1784), un survivant
Par Marjolaine Saint-Pierre
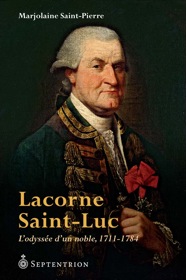
Lacorne Saint-Luc, l’odyssée d’un noble, 1711-1784 |
Remarques liminaires
Montréal, Pointe-à-Callière, samedi, le 1er mars 2014 : Pour la 106e conférence de sa série « Les samedis de l’histoire », la Société historique de Montréal invite Marjolaine Saint-Pierre à présenter dans une conférence-diaporama le parcours étonnant du héros de son dernier ouvrage intitulé Lacorne Saint-Luc, l’odyssée d’un noble, 1711-1784, publié chez Septentrion en 2013.
Lacorne Saint-Luc (1711-1784), un survivant est le titre de cette conférence, illustrée par une centaine de photographies et de documents d’archives choisis par le photographe Lynn-Ernest Fournier, qui retrace les étapes importantes dans la vie de l’officier du roi, chevalier de la croix de Saint-Louis et commerçant qui connut une des carrières les plus éclatantes de la fin du Régime français et du début du Régime anglais en Amérique au milieu du XVIIIe siècle.
Le service militaire, une affaire de famille
Les racines du Canadien Luc de Lacorne dit Saint-Luc sont dans le Massif central, au coeur même de la France, et plus précisément dans le paisible village de Chaptes, situé à 22 kilomètres au nord de la ville industrielle de Clermont-Ferrand, en Auvergne.
Les de Lacorne étaient des nobles d’épée au service du roi de France depuis le XVe siècle. C’est dans leur château de Chaptes, à l’automne de 1667, qu’est né celui qui fonda la branche canadienne des Lacorne. Il s’agit de Jean-Louis de Lacorne de Chaptes, l’aîné de la famille, qui choisit de s’engager dans le métier de ses illustres ancêtres. En 1685, il débarquait en Nouvelle-France avec une commission de sous-lieutenant. Dix années plus tard, il prenait définitivement racine dans la colonie en épousant la fille du premier seigneur de Contrecoeur, Marie Pécaudy. Douze enfants naîtront de cette prestigieuse alliance.
Luc est leur huitième enfant. Il serait né à l’automne de 1711 dans le fief des Lacorne qui fut détaché de la seigneurie de Contrecoeur, cinq ans après le mariage de Jean-Louis et de Marie Pécaudy. C’est clair : Lacorne Saint-Luc était fait pour le service militaire. Cette profession convenait parfaitement à sa forte personnalité et à sa robustesse physique et pouvait lui offrir les privilèges qu’il souhaitait. C’est à l’âge de quinze ans qu’il eut l’autorisation de rallier les rangs des compagnies franches de la Marine qui formaient alors l’armée régulière de la colonie française.
Devenir soldat du roi en Nouvelle-France signifie que le jeune homme était en garnison dans les villes fortifiées ou affecté dans les avant-postes pour protéger les nombreux forts et les frontières de la colonie, qu’il participait aux partis de guerre contre les Iroquois et aux raids contre les Anglais de la Nouvelle-Angleterre qui convoitaient les territoires français.
Ses services, sa bravoure et ses aptitudes furent reconnus pas ses supérieurs et le cadet Lacorne Saint-Luc fut promu enseigne en second à 24 ans, enseigne à pied à 31 ans, lieutenant à 37 ans et enfin capitaine à 44 ans. Il fut décoré de la prestigieuse croix de Saint-Louis, le 1er janvier 1759.
Le commerce des fourrures
Comme plusieurs autres nobles de la Nouvelle-France, Lacorne Saint-Luc décida que la meilleure façon de prospérer dans un pays qui présentait très peu d’options commerciales était d’augmenter son salaire annuel d’officier du roi par le commerce des fourrures. Il s’est alors fait marchand-équipeur pour embaucher des coureurs des bois et pour faire la traite avec les Amérindiens. À partir de 1731 et jusqu’à la fin du Régime français, Lacorne Saint-Luc a signé au-delà de 85 contrats d’engagement pour faire le négoce, entre autres, à Détroit, à Michillimakinac, à Chagouamigon, etc. Aussi, de nombreuses quittances, obligations et procurations démontrent qu’il pratiquait une activité économique intense durant ces années, mais que celle-ci ne remettait aucunement en cause sa carrière militaire.
Agent de liaison auprès des Indiens
L’administration coloniale comptait sur Lacorne Saint-Luc pour entretenir un pacte d’amitié avec plusieurs nations amérindiennes, pour les mener au front et combattre l’ennemi britannique. La longue fréquentation avec ceux-ci lui a permis non seulement d’établir des contacts intimes et des affaires profitables, mais également d’apprendre leurs langues, soit le huron, l’iroquois, l’abénaquis, l’algonquin et le malécite. Sa relation privilégiée avec les Autochtones lui vaudra le titre de « général des Sauvages ».
Durant la guerre de Sept Ans (1756-1763), Lacorne Saint-Luc était sur tous les fronts avec l’élite des Canadiens et leurs alliés indiens à faire la « petite guerre ». Cette forme de guérilla était efficace et déstabilisait l’ennemi, tout en appuyant les manoeuvres des troupes d’assaut et de l’artillerie française. Il n’a pas pris part au combat sur les plaines d’Abraham, le 13 septembre 1759, puisqu’il était en mission au lac Ontario et qu’il collaborait au plan de défense de la région du lac Champlain. Toutefois, il fut blessé à la bataille de Sainte-Foy, l’année suivante, et il fut témoin de la capitulation de la Nouvelle-France signée à Montréal, le 8 septembre 1760.
Naufrage de l’Auguste
Après la conquête de son pays par les Britanniques, Lacorne Saint-Luc dut envisager un exil forcé vers la France. Le 12 octobre 1761, il prenait place à bord du navire marchand l’Auguste, avec 120 autres passagers qu’il connaissait bien, confiant que ce déracinement était temporaire et que Louis XV reprendrait sa colonie.
En route, le vieux rafiot mal équipé affronta plusieurs dangers, de forts courants et de nombreuses tempêtes avant de terminer sa course près des côtes accidentées, au nord de l’île du Cap-Breton. L’Auguste fit naufrage, le 15 novembre 1761, sur les bancs de sable de la baie Aspy. Seuls sept passagers ont échappé à la mort. Lacorne Saint-Luc était de ce nombre.
Il est difficile d’imaginer le chagrin du malheureux qui devait ensevelir les corps défaits de ses parents, amis et compatriotes avant de reprendre sa destinée en main. Lacorne Saint-Luc décida de rebrousser chemin et de marcher pour survivre, malgré son affliction, l’épuisement, les privations et l’intensité du froid hivernal. Le rescapé revint à Québec, le 23 février 1762. Imaginez la surprise des autorités britanniques qui pensaient s’en être débarrassé!
Refaire sa vie
En décidant de rester au pays, Lacorne Saint-Luc dut accepter de vivre dans une colonie anglaise, the province of Quebec, et de renoncer à sa carrière militaire. Il réussit graduellement à s’adapter, à surmonter plusieurs difficultés et à reprendre ses affaires commerciales en main, malgré la dévaluation du papier monnaie, l’interdiction d’importer directement de France et la concurrence farouche des commerçants britanniques.
Ce sont surtout les textiles et les vêtements de luxe qui lui permettront de refaire sa fortune après le changement de régime. De plus, il achètera plusieurs biens fonciers à Montréal et dans ses environs et il prêtera couramment de l’argent à la manière de nos banquiers modernes.
Le fait qu’il soit admis au premier Conseil législatif, sous l’administration de Guy Carleton, ainsi qu’au deuxième Conseil sous Frederick Haldiman, prouve que Lacorne Saint-Luc restait un homme d’influence, même durant sa vieillesse, et qu’il savait s’attirer les bonnes grâces de l’autorité coloniale, comme au temps de la Nouvelle-France.
Le survivant de la guerre de Sept Ans et du naufrage de l’Auguste est décédé dans sa demeure de la rue Saint-Paul à Montréal, le 1er octobre 1784, à l’âge de 73 ans. Avec lui s’éteignait la branche canadienne des Lacorne de Chaptes.
Les Ramezay : une famille noble en Nouvelle-France
Les Ramezay : une famille noble en Nouvelle-France
Par Joëlle Thérien
M.A. Histoire, Université du Québec à Montréal

Aquarelle présumée de Claude de Ramezay, n° 1998.1024
|
Issu de la noblesse française, Claude de Ramezay (1657-1724) est arrivé au Canada en tant que lieutenant des troupes de la Marine en 1685. L’officier s’est très bien adapté à la société coloniale puisqu’il a été en mesure de gravir les échelons militaires et sociaux. Entre 1690 et 1699, il est gouverneur de Trois-Rivières et il épouse, en 1690, Charlotte Denis (1668-1742), une noble canadienne. Le couple et leurs enfants déménagent à Québec en 1699 lorsque Ramezay obtient le poste de commandant des troupes de la Marine. En 1704, il est nommé gouverneur de Montréal, poste qu’il occupe jusqu’à sa mort. Parallèlement à ses activités militaires, Claude de Ramezay, comme plusieurs nobles canadiens, s’implique dans des activités économiques afin d’acquérir un revenu d’appoint. Notamment, il est propriétaire des seigneuries de Ramezay, Monnoir et Sorel et s’implique dans le commerce du bois avec sa scierie à Chambly.
De la mortalité infantile aux occupations des nobles, l’étude de la famille Ramezay illustre plusieurs réalités de la noblesse canadienne sous le Régime français. En ce sens, l’analyse du parcours des enfants du gouverneur de Montréal nous en apprend beaucoup sur le deuxième ordre.
Survivre jusqu’à l’âge adulte
De son mariage avec Claude de Ramezay, Charlotte Denis a mis au monde seize enfants dont cinq sont décédés avant l’âge d’un an. Malheureusement, ce taux de mortalité élevé ne s’écarte guère de ce que l’on observe chez la classe nobiliaire. Effectivement, la mortalité infantile chez les enfants nobles nés au 17e siècle est de 16,5%. Ce taux s’élève à 33,1% entre 1700 et 1734 et, entre 1735 et 1765, il grimpe à 48%! La famille Ramezay reflète donc fort bien la réalité de plusieurs familles nobles du Régime français d’où l’intérêt d’aborder la brève existence de ces nourrissons.
Deuxième enfant du couple Ramezay-Denis, Catherine est née en 1692. Selon son acte de baptême, elle est décédée dans les heures suivant sa naissance. Le troisième enfant du couple dont le nom est inconnu a été ondoyé en 1693 dans la paroisse de Batiscan. Il a peut-être connu le même sort que sa sœur aînée ou il s’agit d’un enfant mort-né. Deux autres enfants sont décédés avant d’avoir atteint deux mois et tout porte à croire qu’ils sont morts en nourrice. Effectivement, leur décès a été enregistré dans des paroisses où les nourrices sont nombreuses puisque François est décédé en 1702 à Beauport et Françoise-Ursule en 1704 à Charlesbourg. De plus, les intervalles entre les naissances des enfants (intervalles intergénésiques) suggèrent que Charlotte Denis n’a pas allaité ses enfants. Il faut dire qu’avoir recours aux services d’une nourrice était une pratique fréquente chez l’élite canadienne de la fin du 17e siècle jusqu’au lendemain de la Conquête. Cette pratique n’est pas sans conséquence sur la mortalité infantile puisqu’elle favorise les naissances rapprochées qui mettent en péril la santé de la mère et du fœtus. Finalement, le dernier enfant du couple Ramezay-Denis, Marguerite-Louise, est décédée avant d’avoir atteint trois mois en 1711. Puisque son décès est enregistré dans la paroisse où résident ses parents, il n’est pas possible d’affirmer qu’elle a perdu la vie chez sa nourrice.
Un autre enfant du couple Ramezay-Denis a péri avant d’avoir atteint l’âge adulte. Il s’agit de Pierre-Timothée qui est décédé en 1706 à l’Hôtel-Dieu de Québec alors qu’il n’avait que sept ans. Par conséquent, sur les seize enfants du couple, dix atteignent l’âge adulte soit six filles et quatre garçons.
Des religieuses, des femmes mariées et des célibataires
Une carrière dans une communauté religieuse est une source de prestige puisque les fonctions importantes sont réservées à l’élite. Catherine (1696-1725) et Charlotte (1697-1767), les deux filles aînées de Claude de Ramezay sont entrées en religion. La première entre chez les Ursulines de Québec et l’autre chez les Augustines de l’Hôpital-Général de Québec. Elles ont toutes deux intégré des établissements populaires chez l’élite et ce, au début de leur vingtaine. Il est fréquent pour les nobles canadiennes d’effectuer leur profession de foi dans la fleur de l’âge. Cette stratégie leur permet d’acquérir l’ancienneté nécessaire pour être élue à des fonctions prestigieuses. D’ailleurs, Charlotte a eu l’opportunité d’accéder à des charges importantes dont le poste de supérieure qu’elle occupe au moment de la Conquête.
Quant aux filles de Claude de Ramezay qui se sont mariées, elles ont toutes deux épousé des nobles canadiens avec une situation enviable. Ces alliances matrimoniales permettent aux Ramezay de demeurer dans le haut de la hiérarchie sociale. Geneviève de Ramezay (1699-1769) se marie en 1721 avec Louis-Henri Deshamps de Boishébert (1679-1736). Promu capitaine dans les troupes de la Marine en 1728, Boishébert est aide-major de Québec et seigneur de La Bouteillerie au moment de son mariage. Élisabeth (1707-1780) épouse Louis de Chaptes de La Corne (1696-1762) en 1744 alors capitaine dans les troupes de la Marine et nouvellement seigneur de Terrebonne. Ayant épousé des hommes plus âgés qu’elles, les deux sœurs se sont retrouvées veuves comme c’était souvent le cas pour les nobles canadiennes. Après la mort de leur époux, elles se sont montrées fort habiles lorsqu’elles ont pris en main la gestion du patrimoine familial et l’avenir de leurs enfants.
Si les deux filles Ramezay qui ont pris mari semblent avoir plusieurs points en commun, celles qui sont demeurées célibataires ont certainement un tempérament fort différent. Louise (1705-1776) est connue pour avoir mené de front plusieurs activités économiques tandis que sa sœur aînée Angélique (1701-1749) ne semble pas avoir partagé cet intérêt pour les affaires puisqu’elle a laissé peu de traces dans les archives. Pourtant, les soeurs ont toutes deux été initiées à la gestion du patrimoine familial par leur mère dans les années qui suivent le décès de Claude de Ramezay. Or, c’est Louise qui prend en main la gestion des trois seigneuries de la famille de même que la scierie de Chambly dont les profits sont divisés entre les héritiers. Elle mène aussi des activités économiques à titre personnel puisqu’elle possède deux scieries et une tannerie. Qui plus est, elle est l’une des rares femmes à s’être fait concéder deux seigneuries.
Des officiers militaires au service du roi
Quant aux quatre fils de Claude de Ramezay, ils ont tous intégré les troupes de la Marine en tant qu’enseigne avant d’avoir atteint dix-huit ans. Les postes d’officiers sont très recherchés par la noblesse canadienne puisqu’ils permettent aux nobles d’avoir un revenu de base tout en bénéficiant du prestige de servir le roi.
L’aîné, Claude de Ramezay fils (1691-1711), a été envoyé à Rochefort en tant que garde-marine en 1707. Sous le Régime français, cette pratique permet à quelques privilégiés de gravir plus rapidement les échelons militaires. Malheureusement pour les Ramezay, Claude est décédé en 1710 à Rio de Janerio alors qu’il était sous les ordres de Jean-François Duclerc lors d’une expédition qui s’inscrit dans le cadre de la guerre de Sucession d’Espagne. Ce conflit ouvre la voie aux corsaires français pour attaquer les colonies ennemies de la France dont le Brésil alors sous domination portugaise.
Un autre fils de la famille Ramezay perd également la vie au combat. Il s’agit de Louis (1694-1717) qui, en 1712, a été promu lieutenant dans les troupes de la Marine. C’est en cette qualité et grâce à sa maîtrise des langues amérindiennes qu’il participe à une expédition contre les Renards (une nation amérindienne ennemie des Français installée à l’ouest du lac Michigan). Son père est alors gouverneur de la colonie par intérim durant le séjour en France de Vaudreuil. Louis avait pour mission de mobiliser trois nations alliées (les Miamis, les Ouyatanons et les Illinois) en vue d’une expédition d’envergure devant compter près de mille hommes. Or, les Amérindiens étant victimes de la rougeole sont peu enclins à fournir des combattants. Malgré tout, le jeune officier est au point de rendez-vous avec quelques Amérindiens, mais le reste des effectifs n’a jamais quitté Michilimakinak à cause d’un problème de ravitaillement. Louis se retire donc à la mission jésuite de Kaskaskia située au sud du lac Michigan pour passer l’hiver avec d’autres Français. Par la suite, plusieurs rumeurs circulent concernant la disparition de Louis et de ses hommes. C’est le récit d’un jésuite qui donne l’heure juste sur les circonstances entourant la mort du jeune officier. Ce dernier et ses hommes auraient été attaqués par un parti de Cherokees alors qu’ils étaient en route vers le fort Détroit. Le jésuite ne précise pas la date de cette escarmouche qui a probablement eu lieu au printemps 1716.
Tout comme ses frères ainés Charles-Hector (1695-1725) était destiné à mener une brillante carrière militaire. Entre 1711 et 1714, il effectue un séjour en France lors duquel il est présenté au ministre de la Marine et où il a la chance d’acquérir une formation militaire en tant que cadet chez les mousquetaires. En 1719, il s’embarque de nouveau pour la France. Cette fois-ci, il accompagne son père qui l’initie possiblement à ses activités économiques. Tout porte à croire que Charles-Hector était destiné à faire fructifier le patrimoine familial. Malheureusement, il périt dans un naufrage un an après la mort de son père dans un navire qui devait le mener en France pour lui permettre de recruter des travailleurs et de l’équipement.
Contrairement à ses frères aînés, Jean-Baptiste-Nicolas-Roch (1708-1777) a eu la chance de vivre suffisamment longtemps pour mener une carrière forte en rebondissement. Effectivement, le cadet est principalement connu pour avoir signé la capitulation de la ville de Québec le 17 septembre 1759 lors de la guerre de Conquête. Par la suite, il est contraint de s’exiler en France et il ne reviendra jamais dans la colonie. Auparavant, il avait participé à plusieurs expéditions militaires dont la campagne d’Acadie en 1746 de laquelle il ressort victorieux. De son mariage avec Louise Godefroy de Tonnancour, un seul de leurs enfants, une fille, atteint l’âge adulte ce qui met fin au patronyme « Ramezay ».
L’étude de cette famille noble a révélé qu’il est intéressant d’analyser les parcours des enfants d’un couple puisque les destins des frères et des sœurs sont liés les uns aux autres. D’une part, lorsque l’un de ses fils obtient une promotion au sein des troupes de la Marine, Claude de Ramezay sollicite immédiatement le poste laissé vacant pour son cadet. Par exemple, lorsque Claude fils quitte la colonie pour Rochefort, c’est Louis qui reprend son poste d’enseigne. Cette stratégie révèle que les parents ont à cœur de favoriser l’avenir de l’ensemble des fils. Quant aux filles, Ramezay a certainement payé une dot élevée pour envoyer Catherine et Charlotte dans des communautés prestigieuses. Le fait qu’elles fréquentent des établissements différents n’est pas anodin puisque cette stratégie permet à des sœurs d’occuper des charges importantes sans se concurrencer. Or, l’aînée, Catherine, meurt avant d’avoir eu la chance d’accéder à de telles charges. Les deux filles qui se sont mariées ont, elles aussi, une position enviable puisqu’elles ont contracté des alliances fort intéressantes en épousant des officiers militaires issus de la noblesse canadienne. Quant à Louise et Angélique, leur statut de célibataire a permis d’éviter un morcellement du patrimoine familial. D’ailleurs, durant le Régime français, un tiers des femmes nobles demeurent célibataires. Finalement, il ne faudrait pas passer sous silence qu’après la mort de Claude de Ramezay, sa veuve confie progressivement la gestion du patrimoine familial à Louise. Son frère Roch étant trop accaparé par ses charges militaires et ses autres frères étant décédés, la cadette de la famille est l’une des rares femmes de cette époque à avoir profité d’une telle opportunité!
À l’occasion du 250e anniversaire de la signature du traité de Paris le 10 février 1763, l’éditeur Septentrion lance une publication sur le sujet
À l’occasion du 250e anniversaire de la signature du traité de Paris le 10 février 1763,
l’éditeur Septentrion lance une publication sur le sujet
Par Gilles Durand
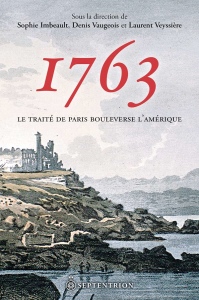
1763. Le traité de Paris bouleverse l’Amérique |
À l’occasion du 250e anniversaire de la signature du traité de Paris, le 10 février 1763, qui transfère la Nouvelle-France à l’empire britannique, l’éditeur Septentrion fait le point sur des questions soulevées dans le cadre d’activités de commémoration, soit des conférences et colloques tenus au Québec et à Paris en 2013. Dans un ouvrage de 456 pages richement illustré, ayant pour titre 1763 Le traité de Paris bouleverse l’Amérique, 17 spécialistes nous entretiennent de cette paix considérée « ni bonne ny glorieuse », sous la codirection de Sophie Imbeault, Denis Vaugeois et Laurent Veyssière.
Le contenu de l’ouvrage
Précédée d’une introduction livrant une vision d’ensemble d’un conflit mettant en cause à la fois la France continentale et coloniale, la publication se divise en trois grandes parties. La première, « Avant le traité de Paris » – 7 textes –, brosse un portrait de la société et de l’économie de la Nouvelle-France : caractères originaux des Canadiens, exploitation des matières premières et commerce triangulaire entre la métropole et ses colonies, alliances avec les Amérindiens, contexte international de la guerre de Sept Ans. La deuxième partie, « Le traité de Paris » – 6 textes –, fait le point sur le traité de paix et ses « non-dits » : sort réservé aux détenteurs de la monnaie de papier, arrivées dans la colonie et départs de celle-ci, accueil et place faits par la mère patrie à ceux qui retournent, vision de l’entente par les métropolitains. La dernière partie, « Après le traité de Paris » – 9 textes –, entrouvre la porte sur les suites du traité pour les Canadiens demeurés au pays : participation à l’administration coloniale et à la vie économique, contacts entre l’ancienne métropole et sa colonie de même qu’entre ceux qui restent et les nouveaux venus anglophones, système de concession des terres, pratiques alimentaires et culturelles, exercice du culte, interprétations données à la Conquête dans le long terme. Pour conclure, les principaux éléments ayant joué lors de la signature de l’entente de paix sont mis dans la balance. Suivent en fin d’ouvrage une chronologie des événements et un index des noms de personnes – incluant quelques noms de lieux et sujets de première importance, tels « Abandon, Indiens alliés des Français, Papier du Canada, Pays d’en Haut, etc. » – permettant aux lecteurs de garder le cap sur le sujet à l’étude et de revenir plus facilement sur des points de vue déjà exprimés.
Quelques questions débattues dans la publication
Les choix de la France lors des négociations
Lors des négociations, la France n’a plus de marge de manœuvre tant au niveau de ses ressources financières que de sa marine de guerre, sans compter une colonie très peu populeuse face aux Treize Colonies britanniques et constituant par là un marché secondaire. Nulle surprise qu’elle accorde la priorité aux droits de pêche et de séchage du poisson dans le golfe Saint-Laurent et aux îles à sucre antillaises. D’un côté, le poisson nourrit les Européens tout en assurant aux pêcheurs, commerçants, armateurs et intermédiaires des profits. La royauté y voit de son côté une source de revenus et l’assurance d’une relève de sa marine de guerre, mise à mal par les Britanniques au cours du dernier conflit. De l’autre, le sucre, une denrée très en demande sur les marchés européens, constitue une source de richesse très importante pour ceux qui sont impliqués dans sa production et sa commercialisation. Les fourrures, quant à elles, n’occupent plus la position enviable des premiers temps de la colonie. Si leur commerce a suscité des activités d’expansion sur le continent nord-américain avec le partenariat des Amérindiens, elles sont appelées à être déclassées par l’exploitation du bois et la colonisation du territoire.
Cession de territoire, abandon des Canadiens et des Amérindiens
Des reproches sont adressés à la France pour avoir cédé trop facilement la Nouvelle-France aux Britanniques. La métropole est taxée d’indifférence, plusieurs partagent le sentiment d’avoir été abandonnés. À preuve, dira-t-on, les pertes occasionnées aux détenteurs de monnaie de papier, l’accueil plus que tiède et les possibilités de carrière très limitées pour ceux qui retournent dans la mère patrie.
La métropole française a-t-elle vraiment le choix de cette cession pouvant être qualifiée de « consentie mais non souhaitée (p. 28) »? La priorité donnée aux droits de pêche en bordure du continent nord-américain n’implique pas nécessairement sa cession complète. De leur côté, les îles sucrières peuvent être vues comme un gain facile : les planteurs britanniques font des pressions auprès de Londres pour ne pas inclure dans l’empire de nouvelles îles antillaises dont la production de sucre viendrait concurrencer la leur.
L’abandon de la vallée du Saint-Laurent et de l’intérieur du continent ne se produit qu’après un effort de guerre acharné, sans compter la contribution importante au peuplement de la colonie des soldats venus combattre. D’ailleurs, Louis XV reconnaît lui-même que la paix de 1763 n’est « ni bonne ny glorieuse » et qu’il vise à éviter le pire en arrêtant la guerre et en signant la paix. Ce n’est pas par hasard que les fêtes qu’il fait organiser en juin 1763 pour faire connaître au grand public le traité, visent tout autant l’inauguration d’une statue équestre à son image que l’entente mettant fin aux hostilités. Les Français, eux, célèbrent bien davantage la fin d’un conflit coûteux en hommes et le retour à une vie normale que la brisure de la chaîne qui les relie à leurs descendants en terre d’Amérique.
Quant aux Amérindiens domiciliés de la vallée du Saint-Laurent, ils ont déjà changé de camp à la signature du traité de paix. Face à leurs anciens alliés français qui accumulent les défaites, ils optent pour la neutralité puis pour la collaboration avec les Britanniques contre leurs semblables du Pays d’en Haut et du Mississippi, en échange de la protection de leurs droits. Malheureusement, faute de précisions sur leurs droits, ils se retrouvent malgré eux usufruitiers du territoire plutôt que propriétaires.
Pour en savoir davantage
Les différentes études dont se compose la publication constituent un apport incontournable à une bonne connaissance des tenants et aboutissants du traité. Leur lecture stimule pour découvrir, au besoin pour redécouvrir des événements importants de notre histoire, de même qu’elle est source d’inspiration pour approfondir des aspects sur lesquels nous croyons que tout est dit et écrit. Pour en savoir davantage, consulter la table des matières et feuilleter l’ouvrage sur le site de Septentrion.
La France en Amérique du Nord et en outre mer
La France en Amérique du Nord et en outre mer
COMMUNIQUÉ
Par Alain Ripaux
Préface de Henri Réthoré, ancien Ambassadeur,
ancien Consul général de France à Québec
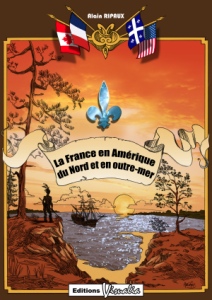
La France en Amérique du Nord et en outre mer. |
Après le succès des livres « Le Québec, une Amérique française », « Images et souvenirs du Poitou-Charentes », « La Vendée, terre de passions » et « La Bretagne, terre de légendes et de traditions », Alain Ripaux, président de Visualia, vice-président de Frontenac Amériques et membre de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, vous propose un nouveau livre historique et cartophile consacré à la francophonie en Amérique du Nord et dans la France d’outre-mer.
Ce nouveau livre d’Alain Ripaux nous fait découvrir les pays francophones d’Amérique : Canada, Québec, Acadie, Louisiane, les communautés francophones d’Amérique et Haïti. Plusieurs thèmes sont développés : la situation de la langue française, l’histoire, les grandes heures de l’Amérique française, les personnages majeurs, la vie culturelle, les Amérindiens et la francophonie dans les provinces et territoires canadiens ainsi que dans certains Etats américains.
L’auteur nous parle également des relations franco-canadiennes, franco-québécoises, franco–américaines et du voyage historique du général de Gaulle en 1967 et des réactions au niveau national et international ainsi que de la coopération franco-québécoise.
Dans ce livre, Nicolas Prévost rend hommage au comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France. Gilbert Lévesque nous parle de l’œuvre de Louis Hémon, pionnier de la francophonie.
La deuxième partie du livre est consacrée à la France d’outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Saint-Pierre et Miquelon, Maurice, Seychelles, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises. Depuis plusieurs siècles, ces pays, départements, territoires font partie de la grande famille des peuples francophones.
Plusieurs thèmes sont développés comme l’histoire, la géographie, le tourisme, la vie culturelle, les hommes célèbres, la cartophilie et la philatélie. Un chapitre est consacré à l’esclavage et son abolition dans les anciennes colonies françaises.
Cet ouvrage de 280 pages et d’une bonne qualité d’édition est illustré de documents anciens, de nombreuses cartes postales anciennes et de timbres de collection du Canada et d’outre-mer.
Ce nouveau livre de référence d’Alain Ripaux intéressera certainement de nombreux amis de l’Amérique française et de la France d’outre-mer.
Les commandes peuvent être adressées directement chez l’auteur : Alain Ripaux – 49, rue Belgrand – 75020 Paris. Courriel : alain.ripaux@laposte.net
Prix public :
24 € + 8 € de port (Québec et Canada)
24 € + 4 € de port (France)
Le numéro 117 de la revue Cap-aux-Diamants est maintenant en kiosque : au sommaire des commémorations et bien autres choses
Le numéro 117 de la revue Cap-aux-Diamants
est maintenant en kiosque :
au sommaire des commémorations et bien autres choses
Par Gilles Durand

Numéro de la revue Cap-aux-Diamants, 1914 Une année mémorable. |
Le présent numéro de la revue Cap-aux-Diamants porte bien son sous-titre 1914 Une année mémorable. Comme celui-ci le laisse entendre, il est question de commémorations, celle que nous venons de vivre à l’occasion du centenaire de la mort de Louis Hémon, le célèbre auteur de Maria Chapdelaine, deux autres à venir, l’une à l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain, compositeur et chanteur québécois, Félix Leclerc, qui a contribué au rayonnement du Québec bien au-delà de ses frontières, l’autre à l’occasion du centenaire du début de la Première Guerre mondiale.
Au chapitre de la Grande Guerre 1914-1918, le lecteur y trouve deux textes, l’un de Serge Bernier sur les 100 ans du Royal 22e Régiment, l’autre de Carl Pépin sur la mobilisation des Français vivant en sol québécois, le 2 août 1914 sur l’ordre du président de la République française. Cette dernière étude incite à un rapprochement avec l’attitude des Québécois qui participent volontairement à la Grande Guerre, mais qui s’opposent à la conscription mise en force à l’été 1917.
D’autres sujets sont également traités dont le lecteur retrouve le titre au sommaire. Nous aimerions cependant attirer l’attention sur une contribution du coprésident québécois de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, Denis Racine. Collectionneur et passionné pour l’étude des médailles, celui-ci présente la médaille frappée pour rappeler le souvenir de George-Étienne Cartier. Dans l’histoire canadienne, Cartier est une figure qui ne laisse pas indifférent : nous le retrouvons, entre autres, impliqué dans la cause des Patriotes et la bataille de Saint-Denis en novembre 1837, comme participant aux conférences de Charlottetown, de Québec et de Londres qui donnent naissance à la Confédération canadienne le 1er juillet 1867 et aussi comme auteur de la célèbre chanson O Canada, mon pays, mes amours. La médaille, écrit Denis Racine, « a été frappée par la maison montréalaise Caron et frères. Elle est en deux modules, l’un d’un diamètre de 80 mm, en bronze et en argent, pour les invités d’honneur, et l’autre de 35 mm, en bronze, pour le grand public. Trois exemplaires en or sont offerts au roi George V (qui avait, depuis Londres, présidé la cérémonie du dévoilement du monument Cartier à Montréal, en 1919), au président des États-Unis et au président de la République française (p. 34). »
Le numéro 6, février-mars 2014, de la Revue Archives et culture : un numéro indispensable aux généalogistes français et québécois
Le numéro 6, février-mars 2014,
de la Revue Archives et culture :
un numéro indispensable aux généalogistes
français et québécois
Par Gilles Durand

Numéro de la Revue Archives et culture
|
Le dernier numéro de la Revue Archives et culture est maintenant en kiosque (6, février-mars 2014). L’équipe de rédaction, composé de Marie-Odile Mergnac, Claire Lanaspre, Jean-Pierre Mir et du coprésident français de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC), Gilbert Pilleul, offre au grand public un périodique indispensable pour les passionnés de généalogie et d’histoire.
Au sommaire figurent d’abord des éléments du patrimoine immatériel, les superstitions autour des naissances et le métier de dentellière. Suivent ensuite deux types d’acteurs dont les Français sont familiers : les maires et les conseilleurs municipaux dont la surveillance par le gouvernement national amène la création de dossiers nominatifs à leur sujet, conservés dans les archives départementales ou municipales; les soldats du temps de Napoléon dont la trace est conservée sur le site du ministère de la Défense Mémoire des hommes. Ceux qui ont des descendants au Québec ne sont pas non plus laissés pour compte : des extraits de l’ouvrage Les premiers Français au Québec publié en 2008 sous la direction de Gilbert Pilleul, brossent les caractéristiques marquantes de la famille québécoise. Pour terminer, deux textes sont reliés à des difficultés rencontrées dans la préparation des arbres généalogiques, soit la consanguinité et les prénoms et noms. Au chapitre des noms et prénoms, il est question de leur histoire et signification, du changement de genre d’un prénom et de son emploi comme nom matronymique.
À signaler, les textes présentés indiquent les guides de recherche lorsqu’il en existe. Mentionnons Retrouver un ancêtre maire ou conseiller municipal, Retrouver un ancêtre grognard (soldat de la Vieille Garde de Napoléon), enfin le tout dernier ouvrage de Marcel Fournier Retrouver des cousins canadiens. À coup sûr, la revue ne manquera d’attirer les généalogistes français et québécois. Le coprésident québécois de la CFQLMC, Denis Racine, écrivait d’ailleurs : « Combien de fois ai-je vu des généalogistes se rendre en France et être plus émus devant l’église du village d’où est parti leur ancêtre que devant la tour Eiffel ».
Bernardin, Louis, Louis Riel avant et après : Réflexions (Saint-Boniface, à compte d’auteur, février 2013, 166 p.)
Bernardin, Louis, Louis Riel avant et après : Réflexions
(Saint-Boniface, à compte d’auteur, février 2013, 166 p.)
Publié à compte d’auteur, en vente au :
Centre du patrimoine
340, rue Provencher
Saint-Boniface (Manitoba) R2H 0G7
Tél. : 1-204-233-4888
ou
La Boutique du livre
130, rue Marion
Saint-Boniface (Manitoba)
Tél. : 1-204-237-3395
Bulletin n°38, juin 2014
Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC)
1. Vie de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC) et des partenaires
- Un devoir de mémoire : le dépôt d’une gerbe de fleurs par les deux coprésidents de la CFQLMC dans l’un des cimetières militaires de Chérisy pour rappeler la contribution des soldats du 22e Régiment, par Gilles Durand
- Assemblée générale de la section québécoise du 17 avril 2014, par Yves Laliberté, secrétaire général et trésorier
- La lettre d’information de la section française de février 2014 et de mai 2014 par Monique Pontault, secrétaire générale
- Les coprésidents québécois et français nous entretiennent :
• Denis Racine sur la médaille George-Étienne Cartier (1814-1873) ;
• La guerre de 14/18 vue du Québec, propos de Gilbert Pilleul recueillis par Joël Broquet, ACIP Bulletin hebdomadaire, n° 1497 du lundi 7 avril 2014
2. Prix, reconnaissances et distinctions
- Francine Lelièvre, lauréate du « Prix du service méritoire » 2014 remis par l’Association des musées canadiens le 9 avril 2014
- Remise de la médaille de l’Assemblée nationale du Québec à trois grands amis du Québec, Marie-Agnès Castillon, Janine Giraud-Heraud et Georges Poirier, pour leur engagement indéfectible envers la relation franco-québécoise
3. Expositions, congrès, colloques, conférences et activités publiques
- Au Centre d’histoire de Montréal, Exposition permanente Traces. Lieux. Mémoires : l’histoire de Montréal, une histoire de « gens qui l’ont habitée et qui l’habitent encore », de « lieux et de mémoires qui créent un présent et dessinent un avenir »
- Jusqu’au 4 janvier 2015, au Musée Notre-Dame de Québec de la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, Exposition Le trésor de Notre-Dame : quatre siècles de ferveur et de mémoire
• Voir aussi sur le site du Musée
• Pour rejoindre le Musée - Jusqu’au 30 août 2015, au Musée de l’Amérique francophone, Exposition Révélations. L’art pour comprendre le monde. Révélations artistiques, symboliques et historiques.
• L’exposition offre un panorama tant stylistique qu’historique grâce à plus d’une centaine d’œuvres tirées de la collection des prêtres du Séminaire de Québec, qui compte environ 900 peintures européennes et canadiennes, près de 25 000 œuvres sur papier, une centaine de sculptures et plus de 1 000 pièces d’orfèvrerie - Du 17 au 20 juin 2014 à Montréal, 48e Colloque annuel de l’Association des cartothèques et archives cartographiques du Canada (ACACC), sous le thème Au cœur d’une profession : préserver et diffuser le savoir géographique
- Les 26 et 27 septembre 2014, à l’Université d’Ottawa, Congrès annuel de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique sous le thème Le catholicisme au Canada et les minorités nationales et ethniques : contributions et tensions (XIXe et XXe siècles) – Appel de communications
- Du 16 au 18 octobre 2014 à Québec, 67e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, sous le thème Pouvoir, politique et résistance
4. Commémoration, généalogie et toponymie
- 2013, Colloques sur les traités de Paris tenus à Montréal et à Paris en 2013, publication prochaine des actes – Voir procès-verbal de l’assemblée générale du 17 avril 2014
- Du 6 février au 28 décembre 2014 à Québec, Fêtes du 350e anniversaire de la fondation de la paroisse de Notre-Dame-de-Québec en 1664 – Programmation
• Voir aussi la désignation de la fondation comme événement historique dans le Répertoire du patrimoine culturel - Le 4 avril 2014 à Paris, Colloque Mobilisations, tensions, refus en 1914-1918, le Québec dans la guerre, à l’occasion de la commémoration du centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale – Programme et résumé des conférences
- Du 30 avril au 28 septembre 2014 à Québec, Fêtes du 375e anniversaire de l’arrivée des Augustines et Ursulines organisées par ces deux communautés qui ont rempli des rôles clés d’hospitalières et d’enseignantes – Programmation
- À compter du 5 mai 2014, Nouvelle série d’Apocalypse, la Première Guerre mondiale, en cinq documentaires, présentée sur TV5 les lundis 21 h et les jeudis 19 h – Peut être écoutée en différé sur TV5Vidéo le lendemain de la diffusion
- Du 11 mai au 8 juin 2014, le dimanche à 16 h, Claude Legault assume la narration d’une série documentaire de cinq heures sur la Première Guerre mondiale, réalisée par Radio-Canada – Peut être écoutée en différé
- À compter du 29 mai 2014, au Musée Royal 22e Régiment de la Citadelle de Québec, Exposition permanente « Je me souviens » 100 ans d’histoire du Royal 22e Régiment
- Du 4 juillet au 10 août 2014, Au Musée des Ursulines de Québec, 12, rue Donnacona, en collaboration avec les Augustines, Exposition Mission Nouvelle-France : « une occasion unique d’apprécier les collections ethnographique et artistique héritées du Régime français
- Jusqu’au 3 août 2014, à la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, Exposition Été 14 – Les derniers jours de l’ancien monde
- Du 14 août au 11 novembre 2014, au Musée Royal 22e Régiment de la Citadelle de Québec, Exposition temporaire 1914-1918 La Grande Guerre vue par les peintres français : Œuvres des collections du musée de l’Armée – Paris
- Du 24 au 26 septembre 2014 à Québec, Colloque des Ursulines de Québec, des Augustines de Québec et de la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l’Université Laval, sous le thème Risquer un monde nouveau, 375 ans de vie et d’audace pour souligner le 375e anniversaire de l’arrivée des deux communautés religieuses en Nouvelle-France
- Du 25 au 27 septembre 2014 à Montréal, Colloque Pieds nus dans l’aube… du XXIe siècle : L’œuvre de Félix Leclerc, héritage et perspectives
- Du 16 au 18 octobre 2014 à Québec, Colloque de la Faculté de droit de l’Université Laval et du Groupe de recherche sur les sociétés plurinationales de l’Université du Québec à Montréal sous le thème La conférence de Québec, 1864. 150 ans plus tard – Comprendre l’émergence de la fédération canadienne
- 23 et 24 octobre 2014 à Sainte-Adèle, 52e Congrès de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ), Thème La Grande Guerre
- Les 30 octobre et 1er novembre 2014, au Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu, Colloque : 1914-1918 Le Québec s’en va-t-en guerre – Programme et inscription
- De novembre 2014 à novembre 2015, au Château Ramezay à Montréal, Exposition sur le régiment de Carignan-Salières à l’occasion du 350e anniversaire du régiment
- Le 22 novembre 2014 à Québec, Colloque sous le thème État civil d’hier à aujourd’hui, organisé par la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs et la Société de généalogie de Québec – dans le cadre de la commémoration du 475e anniversaire de la signature de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts et du 20e anniversaire de la mise en place de la Direction de l’état civil
- 8 et 9 décembre 2014 à Québec, Colloque de la Chaire de théologie Monseigneur-de-Laval, Université Laval, sous le thème De l’invention d’une paroisse à la réinvention des paroisses, à l’occasion du 350e anniversaire de la fondation de la paroisse Notre-Dame-de-Québec
- Le point concernant la recherche des origines familiales des pionniers et pionnières du Québec ancien dans le Fichier Origine, 15 avril 2014, par Marcel Fournier
- Édith Piaf : assurer la permanence de sa mémoire par la toponymie, par Gilles Durand
5. Archéologie et patrimoine
- Le 11 janvier 2014, lancement d’une nouvelle section consacrée exclusivement à l’archéologie, disponible dans le site Internet de la Ville de Québec
- Le chanteur Félix Leclerc est désigné personnage historique du Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel le 30 janvier 2014.
• Voir aussi le Répertoire du patrimoine culturel du Québec - 350e anniversaire de la parution en 1664 à Paris de l’ouvrage de Pierre Boucher Histoire véritable et naturelle des mœurs & productions de la Nouvelle-France… – Voir procès-verbal de l’assemblée générale du 17 avril 2014, rubrique 4
- Découverte dans le fleuve Saint-Laurent d’un fort submergé datant de 1759 près de Prescott (Ontario) : le fort Lévis
- La pratique du canot à glace sur le fleuve Saint-Laurent comme élément du patrimoine immatériel
6. Muséologie
7. Archives
- 1753-1755 : un temps où la France remportait des victoires sur l’Angleterre en Amérique. Quatre ans plus tard… – Présentation, annotée par Jacques Portes, du journal de Monceau, soldat des compagnies franches de la Marine
- Archives de Radio-Canada – Guerres et conflits : Des sources pour découvrir les dimensions cachées de la 1re et de la 2e Guerre mondiale
8. Histoire
- Contribution du Nouveau Monde à l’Ancien Monde (Une), par Jacques Mathieu et Alain Asselin
- Dossier Les Filles du Roy
• Les Demoiselles de 1667 par Romain Belleau
• Départ au Canada des Filles du Roy – Geste de mémoire par Maud Sirois-Belle
• Les sœurs de Boisandré par Danielle Lecampion
• La vie de Marie Lebrun par Bernadette Foisset - Lacorne Saint-Luc (1711-1784), un survivant, par Marjolaine Saint-Pierre
- Ramezay : une famille noble en Nouvelle-France (Les), par Joëlle Thérien
9. Tourisme culturel
- Délégation générale du Québec à Paris, Le Québec au cœur de Paris – Carte des principaux lieux parisiens liés au Québec, 2014
- Villes et villages de France, …berceau de l’Amérique française (Ces) : le douzième et dernier ouvrage de la collection Nord-Picardie paraîtra fin mai 2014 – voir brève présentation et bon de commande;
• pour une présentation de l’ensemble de la collection, voir Mémoires vives n° 29, décembre 2009 n° 29, décembre 2009 - Mémoire de la Première Guerre mondiale. Voyage commémoratif en France et en Belgique du 1er au 12 novembre 2014 en compagnie de Gilbert Pilleul, historien et coprésident de la CFQLMC – Prendre contact avec Vincent Deghetto, Voyages CAA Québec vdeghetto@caaquebec.com
- Voir ci-dessous le « guide Mendel » Le Séminaire de Québec, un patrimoine exceptionnel en suggestion de lecture
10. Suggestions de lecture
Livres
- Bernardin, Louis, Louis Riel avant et après : Réflexions (Saint-Boniface, à compte d’auteur, février 2013, 166 p.)
- Bourdeau, Laurent, Pascale Marcotte et Habib Saidi, Routes touristiques et itinéraires culturels. Entre mémoire et développement (Tome 1, Presses de l’Université Laval, 2013, 505 p.), Présentation sur le site de l’éditeur
- Charland, Jean-Pierre et Sabrina Moisan, Histoire du Québec en 30 secondes (L’) (Montréal, Éditions Hurtubise, 2014, 160 p.), Présentation sur le site de l’éditeur
- Costelle, Daniel et Isabelle Clarke, Apocalypse : La 1ère Guerre mondiale (Éditions Flammarion, 2014), Présentation sur le site de l’éditeur
- Deschênes, Gaston et Denis Vaugeois, dir. Vivre la conquête à travers plus de 25 parcours individuels (Tome 2, Québec, Septentrion, 2014), 320 p., Présentation sur le site de l’éditeur
- Filteau, Jean-Claude et Daniel Abel, Joyeuse lumière. Les vitraux de Notre-Dame de Québec, Québec, Septentrion, 2014, 224 p.
• Voir aussi le site Internet de l’éditeur - Fonck, Bertrand et Laurent Veyssière, dir., Guerre de Sept Ans en Nouvelle-France (La) (Québec, Septentrion, 2012, 400 p.), Présentation sur le site de l’éditeur
• Voir aussi - Fonck, Bertrand et Laurent Veyssière, La fin de la Nouvelle-France (Tome 1, Paris, A. Colin / Ministère de la Défense, 2013, 499 p.)
• Voir ci-dessous tome 2 Veyssière, Laurent, dir., La Nouvelle-France en héritage. - Fournier, Martin, Les Aventures de Radisson : Sauver les Français (Tome 2, Québec, Septentrion, 2014, 440 p.), Présentation sur le site de l’éditeur
- Furstenberg, François, Quand les États-Unis parlaient français. À paraître à l’été 2014 – Voir le site du Canal Savoir Les Belles Soirées de l’Université de Montréal Épisode 9
- Graveline, Pierre, dir., Dix journées qui ont fait le Québec (Montréal, VLB éditeur, 2013, 264 p.), Présentation sur le site de l’éditeur et sur le site de la Fondation Lionel-Groulx
- Imbeault, Sophie, Denis Vaugeois et Laurent Veyssière, 1763. Le traité de Paris bouleverse l’Amérique (Québec, Septentrion, 2013, 456 p.), Compte rendu par Gilles Durand
- Joutard, Philippe, Histoire et mémoires, conflits et alliance (Paris, Éditions La Découverte, 2013, 240 p.), Présentation sur le site de l’éditeur
- Labrecque, Paul, L’église Notre-Dame-des-Victoires. Un monument historique sur la place Royale à Québec, Québec, Septentrion, 2014, 160 p.
• Voir aussi le site Internet de l’éditeur - Gauthier Larouche, Georges, L’église pionnière de Québec. Origines et fondateurs (1615-1664), Québec, Septentrion, 2014, 184 p.
• Voir aussi le site Internet de l’éditeur - Lebel, Jean-Marie, La paroisse Notre-Dame de Québec. Ses curés et leurs époques, Québec, Septentrion, 2014, 352 p.
• Voir aussi le site Internet de l’éditeur - Légaré, Denyse, L’inspirante basilique-cathédrale. L’architecture de Notre-Dame de Québec, Québec, Septentrion, 2014, 176 p.
• Voir aussi le site Internet de l’éditeur - Manfrin, Frédéric et Laurent Veyssière, dir. Été 14 : les derniers jours de l’ancien monde (Paris, Bibliothèque nationale de France / Ministère de la Défense, 2014, 279 p.) – Catalogue de l’exposition présentée à la Bibliothèque nationale de France
- Mendel, David, Le Séminaire de Québec, un patrimoine exceptionnel (Guides Mendel, Québec, Éditions Sylvain Harvey, 2013, 160 p.), Présentation sur le site de l’éditeur
- Mesli, Samy, Coopération franco-québécoise dans le domaine de l’éducation (La) (Québec, Septentrion, 2014, 380 p.), Présentation sur le site de l’éditeur
- Morissette, Michel, Benoît Grenier et Alex Tremblay, La recherche sur le régime seigneurial d’hier à demain – Cahier des résumés [des communications dans le cadre du colloque du 14 mars 2014 tenu à l’Université de Sherbrooke] – 2014
- Moussette, Marcel et Gregory A. Waselkov, Archéologie de l’Amérique coloniale française (Collection Réflexion, Montréal, Lévesque éditeur, 2014, 464 p.), Présentation sur le site de l’éditeur
- Pépin, Carl, Au Non de la Patrie. Les relations franco-québécoises pendant la Grande Guerre (1914-1918) (Lévis, Québec, Fondation Fleur de Lys, 2013, 436 p.), Présentation sur le site de l’éditeur
- Ripaux, Alain, La France en Amérique du Nord et en outre-mer (Gentilly, Éd. Visualia, 2013), Communiqué par l’auteur
- USITO – Dictionnaire en ligne de la langue française sous la dir. éditoriale d’Hélène Cajolet-Laganière et de Pierre Martel, analyse par Claude Poirier, professeur associé, Université Laval
- Veyssière, Laurent, dir., La Nouvelle-France en héritage (Tome 2, Paris, Armand Colin / Ministère de la Défense, 2013, ), Présentation sur le site de l’éditeur
Revues
- Actualités UQAM – Bulletin électronique de l’Université du Québec à Montréal, 9 avril 2014, Texte Se souvenir de 14-18 et entrevue du professeur d’histoire Andrew Barros, par Claude Gauvreau
- Cap-aux-Diamants – La revue d’histoire du Québec, voir le sommaire du n° 117 (printemps 2014) sous-titré 1914 Une année mémorable
• Voir aussi présentation sur le site de l’éditeur - Revue Archives&Culture, voir sommaire du n° 6 (février-mars 2014)
• Voir aussi une présentation sur le site de la CFQLMC - La revue des diplômés de l’Université de Montréal, n° 426.printemps 2014, Texte Il y a cent ans… La Grande Guerre, entrevue avec le professeur Carl Bouchard par Martin Lasalle, p. 24-25 – Voir aussi le Journal Forum 14 avril 2014, texte La grande guerre Cent ans plus tard
Sites et collections numériques
- Bibliothèque et Archives Canada, Projet nous nous souviendrons d’eux : Recherche relative au cénotaphe – Dossiers militaires de la Première Guerre mondiale
- Centre de la francophonie des Amériques, Bibliothèque numérique de la francophonie des Amériques, Présentation sur le site du Centre
- Inventaire national des monuments commémoratifs militaires canadiens, par la Direction Histoire et patrimoine du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes INMCMC
- Institut des femmes franco-américaines (L’) / Franco-American Women’s Institute
- Québec et les guerres mondiales (Le) – Site explorant l’histoire socio-militaire, politique, diplomatique et culturelle du Québec pendant les deux grandes guerres, animé par Sébastien Vincent, enseignant et historien, fondateur et éditeur du site, et par Frédéric Smith, chargé de projets et historien à la Commission de la capitale nationale du Québec, webmestre et éditeur adjoint du site Le Québec et les guerres mondiales
- Répertoire d’œuvres du patrimoine littéraire québécois, par l’Union des écrivaines et des écrivains québécois : « comprend environ 150 titres d’œuvres écrites ou publiées au Québec depuis les débuts de la Nouvelle-France jusqu’en 1950, …choisies sur la base de leur intérêt littéraire ou historique dans quatre grandes catégories : le théâtre, la poésie, les romans, nouvelles et contes, et les œuvres non romanesques… Le répertoire permet d’accéder directement aux livres en version numérique lorsqu’ils existent dans ce format… »
